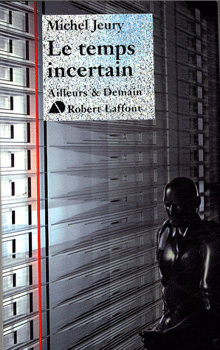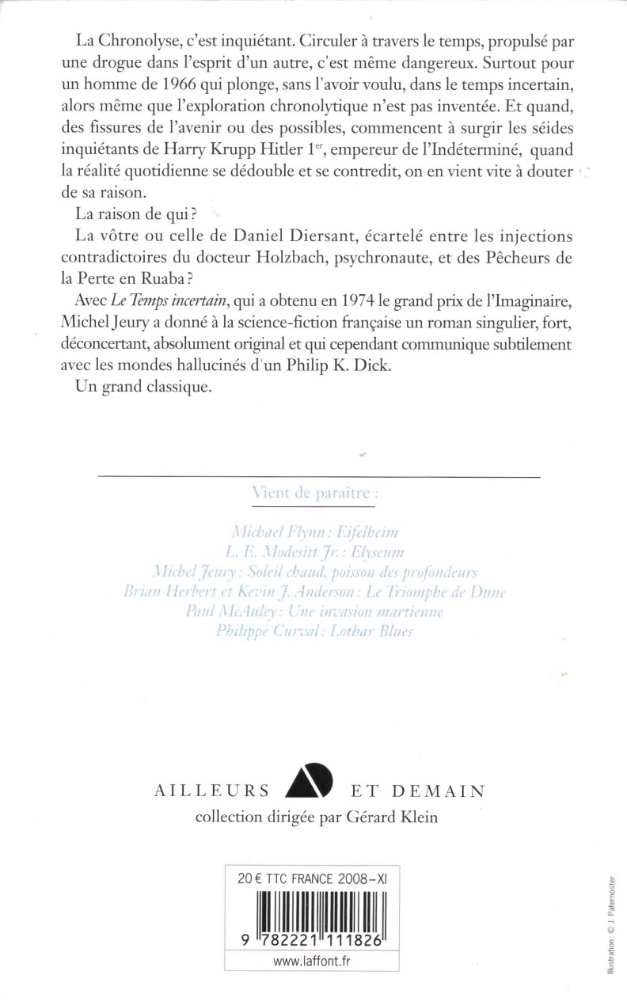|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Le Temps incertain
Michel JEURY Première parution : Paris, France : Robert Laffont, Ailleurs et demain, 1973 Cycle : Garichankar / Trilogie Chronolytique vol. 1  Illustration de Jackie PATERNOSTER Robert LAFFONT (Paris, France), coll. Ailleurs et demain   Dépôt légal : novembre 2008, Achevé d'imprimer : novembre 2008 Réédition Roman, 288 pages, catégorie / prix : 20 € ISBN : 978-2-221-11182-6 Format : 13,5 x 21,4 cm✅ Genre : Science-Fiction
Quatrième de couverture
La Chronolyse, c'est inquiétant. Circuler à travers le temps, propulsé par une drogue dans l'esprit d'un autre, c'est même dangereux. Surtout pour un homme de 1966 qui plonge, sans l'avoir voulu, dans le temps incertain, alors même que l'exploration chronolytique n'est pas inventée. Et quand, des fissures de l'avenir ou des possibles, commencent à surgir les séides inquiétants de Harry Krupp Hitler 1er, empereur de l'Indéterminé, quand la réalité quotidienne se dédouble et se contredit, on en vient vite à douter de sa raison.
La raison de qui ?
La vôtre ou celle de Daniel Diersant, écartelé entre les injections contradictoires du docteur Holzbach, psychronaute, et des Pêcheurs de la Perte en Ruaba ?
Avec Le Temps incertain, qui a obtenu en 1974 le grand prix de l'Imaginaire, Michel Jeury a donné à la science-fiction française un roman singulier, fort, déconcertant, absolument original et qui cependant communique subtilement avec les mondes hallucinés d'un Philip K. Dick.
Un grand classique.
Sommaire
Afficher les différentes éditions des textes1 - Alain SPRAUEL, Bibliographie des œuvres de Michel Jeury, pages 263 à 273, bibliographie Critiques des autres éditions ou de la série
Le nom de Michel Jeury est inconnu, mais l'auteur ne l'est pas. Il s'agit en effet de l'écrivain qui, sous le pseudonyme d'Albert Higon, a publié en 1960 au « Rayon Fantastique » deux romans remarqués : Aux étoiles du destin (une des meilleures réussites de la SF française de l'époque) et La machine du pouvoir ( qui obtint le prix Jules Verne). Après treize ans de silence, c'est avec plaisir qu'on enregistre ce retour de Michel Jeury à la science-fiction. D'autant que sa rentrée s'opère avec un superbe roman, basé sur le plus passionnant des thèmes de la science-fiction : le déplacement dans le temps. Comme l'écrit le rédacteur de la notice au dos de la couverture, ce roman « communique subtilement avec les mondes hallucinés d'un Philip K. Dick ou avec les variations temporelles d'un Gérard Klein ». (Quand on sait que le rédacteur en question est très vraisemblablement Klein lui-même, en tant que directeur de collection, la mention ne manque pas de saveur... surtout qu'il y a quand même eu d'autres auteurs qui se sont, plus que lui, attaqués au voyage temporel.) En fait, la filiation avec Dick est évidente — et avouée par Jeury qui place en exergue de son livre une citation de l'auteur d'Ubik. Comme dans ce dernier roman, comme aussi dans Le dieu venu du Centaure, la trajectoire à travers le temps n'a pas ici la belle géométrie rigoureuse d'une quelconque Patrouille du Temps à la Poul Anderson. Elle est mouvante, flottante, ambiguë, d'où cette idée du temps « incertain » du titre. Comme les personnages de Dick, ceux de Jeury usent d'une drogue pour se transférer en d'autres points du continuum : transfert psychique, et qui pourtant influe sur une réalité en perpétuelle transformation (l'esprit des voyageurs peut habiter celui d'hommes du passé et, par là, modifier la trame de la durée). Avec cet ouvrage, Klein gagne son pari : pour la première fois, un volume français paru dans sa collection est au même niveau de qualité que la plupart des œuvres anglo-saxonnes qu'il y côtoie. Serge BERTRAND
Lorsqu'on veut parler du futur, on ne peut plus, désormais, ignorer le présent qui s'impose comme une référence à laquelle il est impossible d'échapper. Le présent a une sale gueule, donc un avenir peu reluisant : « La chaleur, le manque d'eau, la puanteur, l'air gras et étouffant, les baraques qui ressemblent à des forteresses, les gens barricadés la nuit, et le jour, des foules grouillantes, braillantes et puantes, la misère, la surpopulation, les déchets... Et un flic derrière chaque tas de merde ! » (p. 128). Ces stéréotypes inscrits dans notre réalité quotidienne permettent de dresser de jolis petits décors dont quelques phrases suffisent à imposer la réalité : un « gratfer » traversant de mornes campagnes dans « l'Europe industrielle (qui) retournait au désert », des « paysans en armes », des « heureux » qui fument du chanvre de Berg et jouent du « nagoam »... et on y est ! Tout est en germe dans le présent : ce qui frappe le narrateur de 1966, en France, c'est « l'extrême inégalité, l'écart entre les hautes classes et les plus basses. (...) Et puis... cette tristesse, cette lassitude, ce... ce goût de mort... » qui annoncent déjà HKH. HKH, trois lettres qui claquent comme le fouet d'un garde-chiourme — comme ont déjà claqué d'autres sigles semblables : SS, NKVD, CIA... HKH, c'est l'empereur-patron-marchand fou qu'annonce le monde fou des années 60 (« La patrie aux patrons, ça fait même un chouette slogan ! » — p. 68), que suscite la pourriture des années 70-80 (« Pollution et répression... Les voitures, les médicaments, les flics, l'argent : ce sont les quatre piliers de leur civilisation » — p. 110). HKH : Harry Krupp Hitler Ier, « né des rêves paranoïaques d'un magnat du vingtième siècle... Hans Karl Hauser », mais on peut prononcer aussi Hermann Kahn Hindenburg, Heinz Kurt Hofman, Howard Kennedy Hughes, Honeywell K. Heydrich, Hercule Kissinger Hadès, tout ce que vous voudrez... HKH, c'est la puissance maléfique de l'industrie plus le désordre monstrueux de la guerre, HKH c'est l'enfer moderne, HKH c'est le petit bâtard du nazisme allemand et de l'impérialisme américain (né et grandi sous Oberth et von Braun à la NASA et sous les « Prussiens » de Nixon), qui nous attend au tournant de l'histoire du futur : « Vers 1980, les pays dits développés se trouvaient devant le dilemme suivant arrêter la croissance industrielle ou détruire la planète. On l'avait prévu dès 1970, mais l'opinion tenait pour la croissance. Elle a basculé à partir de 80. Alors, les grandes sociétés capitalistes, et avec elles les fanatiques de ( »industrialisation sauvage, ont été mises en minorité. Il s'ensuivit une réaction de type fasciste. Pour se maintenir, les sociétés ont dû rompre avec les Etats qui se montraient de plus en plus rétifs, sous la pression des masses. Cela devait aboutir entre 85 et 90 à la naissance des empires industriels privés. En Europe, HKH était le plus important et il a vite absorbé tous les autres, selon la loi des monopoles » (p. 109). Et HKH est si envahissant qu'il se met à déborder de son cadre historique : en 2060, sur une Terre à peu près stabilisée économiquement, politiquement, écologiquement, ouverte aux expériences sociologiques en phase culturelle avec le passé (une « Utopie 01 » a été créée en Californie, où virent le jour les premières communautés hippies), les mercenaires de l'empire HKH, pourtant détruit en 1998, sortent du « temps incertain » et s'introduisent dans le continuum. HKH, c'est un cancer spatio-temporel, quelque chose de grouillant, de puant, un conglomérat des puissances de l'ombre (flic-fric) qu'on ne peut jamais tuer. Contre HKH, les Hôpitaux Autonomes, qui ont réussi à envoyer des psychronautes dans le passé. Pas physiquement, bien sûr. Mais, grâce à l'absorption d'une drogue chronolytique, des volontaires peuvent plonger dans le passé, en esprit, en rêve, et se fixer un moment dans le courant du temps à l'abri du cerveau d'un contact dont ils captent la personnalité. Ce flot du temps, cependant, reste trouble, mouvant : les psychronautes voyagent dans l'indéterminé, dans le temps incertain, et les séquences qu'ils y vivent par personnes interposées ne sont peut-être pas tout à fait telles qu'elles se sont déroulées dans la matérialité du « véritable » passé. Par leur présence même, les observateurs perturbent, changent le passé. Il se crée ainsi (bien que cela ne soit pas dit explicitement dans le roman) une infinité de lignes parallèles de passé, d'univers parallèles fantomatiques, où certains événements peuvent former une boucle infinie et changeante, « à moins que le temps ne soit lui-même un phénomène mental » (p. 32). Effrayante perspective ! Le temps n'existe peut-être que dans la subjectivité des dormeurs en proie au mebsital, qui créent chacun leur propre univers : « Avant l'accident temporel, il avait souvent eu l'impression que sa vie était un rêve. (...) Que par un brusque retournement le rêve fût maintenant sa vie ne le surprenait guère » (p. 87). Mais dans ce cas, comment en sortir — et comment, et où, lutter contre HKH qui s'infiltre par toutes les fissures, étant entendu que ce sont précisément les premières expériences de chronolyse qui, bouleversant la trame temporelle, ont suscité l'attaque d'HKH dans la matérialité de 2060 ? La solution est sans doute d'interrompre à tout jamais les explorations chronolytiques, afin que le temps incertain se stabilise, que le temps perforé se rebouche. On n'en sait trop rien, nous lecteurs, de même que reste obscure l'utilité de la plongée en 1966 (mais autrement il n'y aurait pas de roman !) du docteur Robert Holzach, dont l'esprit habite dans l'indéterminé celui de Daniel Diersant, un jeune ingénieur chimiste de la S.E.A.G. (Société d'Etudes et d'Applications de Chimie et de Physique), un gros trust franco-allemand qui peut être à l'origine de l'empire HKH. Diersant a été tué, ou il s'est suicidé (ou peut-être n'a-t-il été que blessé dans un accident ?) en novembre (ou en juillet ?) 66, et c'est à l'occasion de son passage dans l'inconscience qu'Holzach peut se mettre en phase avec lui. Mais tout se brouille, Diersant-Holzach (auquel vient se joindre un troisième personnage fantasmatique, Renato Rizzi, double chronolytique de Diersant) revit sans cesse la même séquence, au cours de laquelle il se voit traqué dans la cour de la S.E.A.C. par Forestier, le flic-maison, qui semble se dédoubler ( « Symbolique, ça : les flics qui se multiplient pour barrer la route à l'avenir » — p. 102), puis se transforme peu à peu en une sorte de cyborg au faciès métallique à la solde d'HKH. Finalement, lâché par Holzach qui doit interrompre son expérience, Diersant devient réellement Renato Rizzi, le marin, l'aventurier, l'homme libre qu'il avait voulu être dans le monde normal, et à qui il a véritablement donné naissance dans l'univers second où la chronolyse l'a projeté, la « Perte en Ruaba », et sa plage immense surmontée de deux soleils, où il va vivre désormais, avec la femme qu'il aime, en vrai Robin son de l'anti-monde : « Il ne regrettait pas sa vie étriquée de singe savant, sa collection d'échantillons médicaux, ni la retraite des cadres qu'il ne toucherait jamais ! Il ne regrettait pas la vieille planète sale et bruyante, livrée aux combinats et aux trusts, aux mercantis furieux et aux porcs à visage d'homme » (p. 187). Au contraire, dans cette vie qui lui paraît réelle mais ne dure peut-être, qui sait, qu'une fraction de seconde, celle de sa propre mort, Diersant — Rizzi a enfin trouvé un mode d'existence écologique où « les voies de la technologie devaient se simplifier à l'extrême pour se fondre dans le décor » (p. 257). Avec ce livre complexe, touffu, peu explicite en fin de compte au simple niveau du récit, mais fort clair (je crois l'avoir bien fait sentir) au niveau des intentions, ou de l'idéologie, Michel Jeury continue de tirer des classiques leur substantifique moelle, pour en jouer avec art des variations personnelles. Ses deux romans jadis publiés par le Rayon Fantastique sous le pseudonyme d'Albert Higon sortaient déjà d'eaux aisément reconnaissables : Aux étoiles du destin (prix Jules Verne 1960) était un décalque fidèle de Ceux de nulle part de Carsac ; quant à La machine du pouvoir, elle relevait de certains éléments du Monde des À. Avec Le temps incertain, on monte de plusieurs degrés (le talent de l'auteur, en nette progression, y est aussi pour quelque chose), puisque c'est Philip K. Dick en entier qui se trouve être l'auteur référencé 1. C'est visible dès le premier chapitre, et c'est d'ailleurs avoué au dos de l'ouvrage (« Un roman (...) qui communique subtilement avec les mondes hallucinés d'un Philip K. Dick »). Subtilement ? Non : gros comme ça ! C'est sensible dès les détails (Forestier devenant un cyborg au sourire d'acier comme Palmer Eldrïtch dans Le dieu venu du Centaure ; usage de drogues influant sur la perception de l'univers — ici, mebsital, et chez Dick, D-liss ou K- priss dans Le dieu, élixir d'Ubique dans Ubik, et surtout JJ 180 dans En attendant l'année dernière, et ça éclate dans cette idée globale de plasticité du continuum, où rêve et réalité s'interpénètrent, où le subjectif prend peu è peu la place de la matérialité. Jeury annonce d'ailleurs dès l'abord la couleur, en introduisant son roman par une citation de Dick en personne : « J'ai le sentiment profond qu'à un certain degré il y a presque autant d'univers qu'il y a de gens, que chaque individu vit en quelque sorte dans un univers de sa propre création... » Ceci posé, il serait tentant, au lieu de se fier à un Ebstein né de la dernière pluie, de demander à un spécialiste de Dick, j'ai nommé Gérard Klein, d'analyser en profondeur Le temps incertain. Nous l'avons fait, voici un extrait du résultat : « Cette œuvre (...) est caractérisée par un déplacement lent, mais manifeste, de l'origine de l'aliénation depuis les structures sociales elles-mêmes jusqu'aux structures physiques (et peut-être métaphysiques) de l'univers de l'œuvre. En d'autres termes, les personnages, d'abord conscients du fait que leur aliénation (le fait qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent) provient de l'organisation de la société où ils vivent, projettent progressivement (...) cette aliénation sur l'image « objective » qu'ils se font de l'univers qu'ils habitent. En d'autres termes encore, ils en viennent à percevoir dans la réalité physique le désordre (spatial et temporel) qu'ils savaient encore, à un stade antérieur, résulter seulement de l'effet sur eux des structures sociales aliénantes... » Pour être clair (hum... Klein ne l'aurait-il donc pas été ?), disons que l'idéologie de l'œuvre se subdivise en deux plans : d'abord l'auteur se montre farouchement opposé au système flic-fric-pollution, mais ensuite, au lieu de le combattre par les armes du matérialisme, il choisit la fuite intérieure dans le naufrage, cher à Dick, de la schizophrénie qui manque d'ailleurs de l'engloutir : « HKH est né de mes craintes... des craintes de Daniel Diersant de voir le monde totalement dominé par les monopoles et partagé entre empires privés » (p. 207). Autrement dit, de crainte d'avoir à combattre un ennemi trop puissant, Jeury/Diersant préfère le faire glisser de la matérialité à l'immatérialité de la folie. Tout le monde avait compris, merci ! Mais il me faut maintenant avouer que les lignes ci-dessus empruntées à Klein ne s'adressaient pas à Jeury, mais (voir Fiction n° 182) à Dick lui-même ! Il m'a paru pourtant significatif d'abuser un instant de votre bonne foi, chers lecteurs, en opérant ce petit montage pour bien démontrer à quel point l'interpénétration des deux univers (littéraires) était parfaite, à quel point l'imprégnation de Jeury par Dick était profonde. Jeury admire Dick que Klein publie ; Jeury phagocyté par Dick est publié par Klein : voilà un beau cercle fermé, une belle illustration de la schizophrénie de l'univers de la SF, où auteurs, critiques et directeurs de collection tournent sans fin dans la sphère de cette « littérature de groupe » où il me semble voir par transparence une multitude de petits personnages former une boucle éternelle. (D'ailleurs, par ma plume, Fiction ne vient-il pas de se retourner sur lui-même ? Ce qui peut donner à penser que la chaîne continue : et si Ebstein était un pseudonyme de Klein ? Et si Ebstein était un pseudonyme de Jeury ? Et si Jeury était un pseudonyme de Klein ?...) Ce serait bien embêtant, car cela m'empêcherait peut-être d'écrire que Le temps incertain est le meilleur livre français de SF publié depuis... Bah I Laissons à chacun ses illusions : depuis un certain temps. Notes : 1. Mais il paraît certain que le film de Resnais Je t'aime, je t'aime a dû également influencer l'auteur, ceci étant particulièrement sensible dans le télescopage et la répétition de séquences qui sont en principe cruciales pour le héros, mais dont la signification peut rester obscure au lecteur. Jean-Patrick EBSTEIN
Le docteur Robert Holzach, psychronaute de son état, est chargé par l'hôpital Garichankar d'entrer en contact avec Daniel Diersant, un individu du XXe siècle susceptible de jouer un rôle crucial dans la lutte contre HKH. Ici, normalement, plusieurs questions surgissent à l'esprit du lecteur sagace. Tentons d'y répondre : qu'est-ce qu'un psychronaute ? c'est un voyageur temporel qui utilise des drogues chronolytiques. Que sont les drogues chronolytiques ? des drogues qui agissent sur la perception du temps et permettent de se projeter dans le temps incertain, un plan de la réalité où le temps est non linéaire (et même plutôt entropique) et où l'on peut interagir physiquement. Et qui est HKH ? une entité totalitaire terrifiante ? Harry Krupp Hitler ? Howard Kennedy Hughes ? Honeywell K. Heydrich ? Diersant va vite comprendre que la menace, comme le temps, est variable... Un conseil liminaire nous paraît indispensable à tous ceux qui veulent considérer la SF comme un simple divertissement au premier degré : qu'ils passent leur chemin, car ils sont condamnés 1) à changer d'avis, ou 2) à ne pas dépasser les dix premières pages et à claironner ensuite à qui voudra l'entendre que ce roman est le plus abscons qu'ils ont jamais lu (cette deuxième éventualité risquant d'être la plus fréquente, le chroniqueur adresse sa plus profonde sympathie à tous ces lecteurs déçus). Or, il apparaît évident que Le Temps incertain n'est pas l'un de ces livres qu'on peut juger à l'aune des dix premières pages. Ni même des cent premières. Entendons-nous bien : c'est un roman qui ne facilite pas la tâche au lecteur. Pas question ici d'unité de lieu, d'action et encore moins de temps, évidemment. Les personnages surgissent, les situations s'enchaînent sans logique apparente, se répètent, se télescopent dans un joyeux chaos. Facile d'évoquer Dick : Jeury emprunte beaucoup à son collègue américain. Outre la citation qui sert d'exergue au récit (coup de chapeau au passage : ils ne devaient pas être nombreux, en 1973, à se proclamer disciples de Saint Dick), on retrouve des traces de crise identitaire, des échardes de paranoïa lancinante, un protagoniste complètement paumé dans une réalité truquée. Mais passé ces comparaisons élémentaires, impossible de reprocher à Jeury de n'avoir voulu faire que du Dick. Du plus Dick que Dick, à la rigueur, mais ce serait encore refuser à l'auteur la totale paternité de son roman. Non, Jeury a bien écrit quelque chose de nouveau, quelque chose d'indubitablement intelligent et réfléchi, et somme toute, quelque chose de plutôt plaisant. Pourtant, difficile d'être définitivement convaincu par ce roman. Il évoque plutôt une tentative expérimentale, destinée à rompre une certaine routine littéraire pour faire évoluer les formes traditionnelles du récit vers des rivages inconnus. A ce titre, Jeury évite le piège de l'imposture et a très certainement mérité les louanges et le prix littéraire qui ont salué Le Temps incertain. A noter que deux tomes viendront compléter la trilogie chronolytique de Jeury : Les Singes du temps, et Soleil chaud, poisson des profondeurs, ce qui confortera le lecteur parvenu au bout du récit dans l'idée qu'il n'était décidément pas possible d'en rester là. Et puis il y a le style, qui souvent dépasse le simple talent. Je n'avais jamais lu la moindre ligne de Michel Jeury avant d'ouvrir Le Temps incertain. Si bien des aspects de l'œuvre m'ont laissé dubitatif, des phrases comme “ La route s'enfonçait dans la forêt comme une lame dans un grand corps velu ” m'ont définitivement conquis. Il en faut parfois fort peu. En refermant ce livre, le lecteur éprouvera souvent de la perplexité. De la répulsion, parfois. Mais sûrement pas de l'indifférence. Et pour cela, il sera beaucoup pardonné à Michel Jeury. Julien RAYMOND (lui écrire)
AU VENT EN APPORTE LE TEMPS Il est salubre de relire, 6 ans après, ce roman qui coïncidait avec un réel renouveau de la SF française. D'une part, en se reportant aux ouvrages de Higon, de 13 ans plus anciens, le progrès était évident : une prose nouvelle pour une thématique neuve. D'autre part, en se référant à Dick (voir l'épigraphe) on pouvait avoir l'impression de tenir l'explication : on avait un Dick français ! Avec le recul que nous offre cette réimpression bien venue, illustrée par un Siudmak égal à lui-même, on peut tenter de revenir sur la nouveauté de cette parole. Pour faire bref : la rupture avec la prose de SF antérieure est tentée, certes ; mais ce n'est évident qu'aux moments d'« accrochage » du lecteur. Et, de ce point de vue, le début (comme souvent chez Jeury) est admirable — l'« américanisation » du style (mettre en scène plutôt que raconter) est parfaitement maîtrisée ; ce qui n'empêche pas Jeury de narrer, à la façon traditionnelle. Le lien est articulé entre la thématique des modifications temporelles et les techniques d'écriture (répétitions de mômes scènes, à valeurs' différentes) et ce, pour la première fois peut-être dans la SF française depuis Drode : des effets textuels d'obsession en dérivent. Enfin, l'univers évoqué, avec son complexe phordal, est hallucinant ; tout comme l'idée originale des univers temporels fantômes qui tentent de se réincarner dans le futur (le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde...). Une réussite donc, à la fois littéraire et politique, au sens plein du terme. Roger BOZZETTO |
| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |