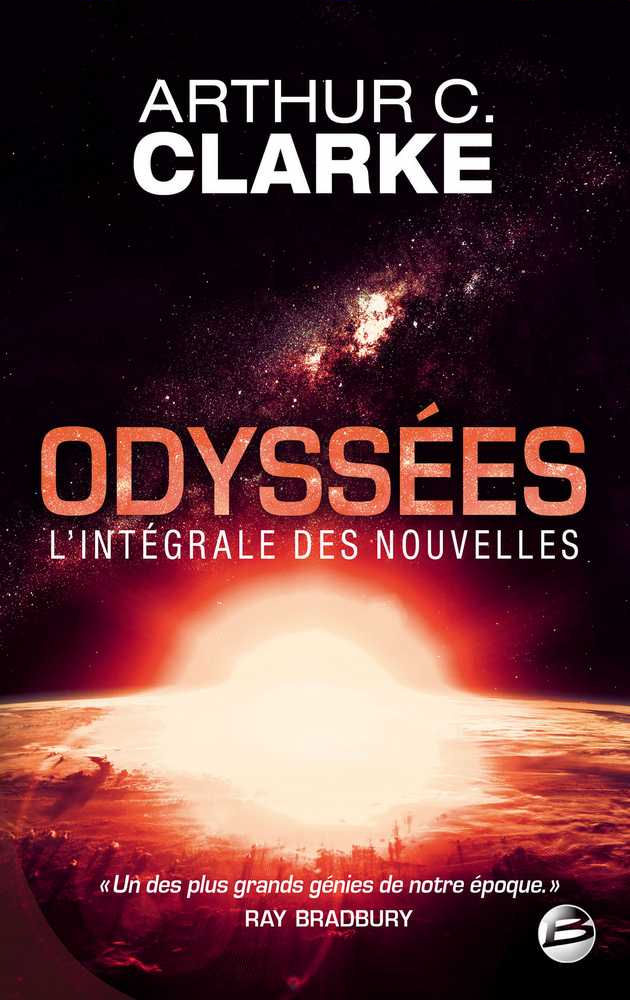|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Odyssées – L'Intégrale des nouvelles
Arthur C. CLARKE Titre original : The Collected Stories of Arthur C. Clarke, 2000 Première parution : Angleterre, Londres : Gollancz/Orion, janvier 2000 ISFDB Traduction révisée par Douglas CLEGG BRAGELONNE (Paris, France), coll. Science-fiction   Dépôt légal : décembre 2016 Recueil de nouvelles, 1128 pages, catégorie / prix : 28 € ISBN : 979-10-281-0153-4 Format : 15,3 x 23,8 cm❌ Genre : Science-Fiction Photographie de couverture : © Shutterstock.
Quatrième de couverture
Arthur C. Clarke est l’un des grands maîtres de la SF moderne. Dans ce volume sont réunies 106 nouvelles, comprenant plusieurs récits inédits en français. On retrouve les classiques comme La Sentinelle (point de départ du film 2001 : l’odyssée de l’espace), Les Neuf Milliards de noms de Dieu, L’Étoile et Face-à-face avec Méduse, mais aussi des histoires moins connues qui révèlent d’autres facettes de l’auteur. Chantre de la conquête de l’espace – on a droit ici à un véritable Grand Tour du système solaire –, Clarke fut également prophète de l’ère des télécommunications universelles, explorateur des fonds sous-marins, humoriste et commentateur de l’aventure humaine dans un univers recelant encore bien des mystères. Un ouvrage aussi complet que définitif, qui aura sa place dans la bibliothèque de tout amoureux de la science-fiction. Sir Arthur C. Clarke (1917-2008) est l’un des plus grands écrivains de science-fiction de l’histoire avec H.G. Wells et Isaac Asimov. Il a livré d’innombrables classiques et des chefs-d’oeuvre tels que le célèbre 2001 : l’odyssée de l’espace ou encore le cycle de Rama. Son oeuvre visionnaire et humaniste a influencé d’autres grands auteurs comme Stephen Baxter. Critiques des autres éditions ou de la série
Décidément, les éditions Bragelonne aiment Arthur C. Clarke. Après avoir inscrit une partie de sa production romanesque au catalogue Milady, elles publient aujourd’hui Odyssées, un pavé de plus de mille pages réunissant l’intégralité de ses nouvelles, soit une centaine de textes parus sur une période de soixante ans. Le premier intérêt d’un tel travail éditorial est de mettre en lumière l’évolution de l’auteur au fil du temps ainsi que les grandes tendances de son œuvre. La passion initiale de Clarke aura été la conquête de l’espace, qu’il n’a jamais cessé de mettre en scène, de la manière la plus variée et la plus réaliste possible. De la vie à bord d’une station spatiale à l’exploration des autres planètes du système solaire et au-delà, l’auteur s’est évertué à convaincre ses contemporains de la faisabilité d’un tel challenge, mais aussi de sa nécessité. Car au-delà des aspects techniques de cette conquête, elle pose la question de la place de l’homme dans l’univers. Et ce sont justement les questionnements métaphysiques de Clarke qui donnent naissance à ses meilleures nouvelles, parmi lesquelles « La Sentinelle », texte dont l’idée centrale sera reprise dans 2001, Odyssée de l’espace, ou « L’Éternel Retour », dont le récit se déroule sur des dizaines de millions d’années. Dans le même ordre d’idées, la rencontre avec l’Autre occupe une place prépondérante dans l’œuvre d’Arthur C. Clarke, et il est rare qu’elle dégénère en conflit. Au contraire, l’écrivain n’a de cesse de mettre en scène la collaboration entre des espèces que tout oppose à priori, comme dans « Une Aube nouvelle » ou « Rencontre à l’Aube », pour ne citer que les plus connus. À l’inverse de toute une école de science-fiction dans les années 50, l’extraterrestre chez Clarke est bien plus volontiers une source de fascination, voire de beauté, que d’effroi. Odyssées permet également de revenir aux sources de l’œuvre romanesque de l’auteur. Certaines nouvelles ont par la suite été directement incorporées au sein de romans, d’autres contiennent en germe les idées qu’il développera plus tard. Ainsi, bien avant de visiter Rama, ses personnages se retrouvaient face à des artefacts dont la conception défie l’entendement, qu’il s’agisse d’un gigantesque mur coupant un monde en deux (« Le Mur des ténèbres », 1949) ou d’une lune qui s’avère être un vaisseau spatial (« Jupiter Cinq », 1953). Ceci dit, toutes les nouvelles au sommaire d’Odyssées ne sont pas bonnes. Un bon nombre d’entre elles ne sont au mieux qu’anecdotiques, notamment toutes celles prenant pour cadre le White Hart, ce pub où se réunissent écrivains et scientifiques pour se raconter d’improbables histoires d’inventions plus farfelues les unes que les autres. De même, parmi les textes qui étaient restés inédits jusqu’à ce jour, on cherchera en vain un chef-d’œuvre oublié. Le plus intéressant est sans doute « Le Continuum du fil », qui date de 1998 et qui reprend en la modernisant une idée que Clarke développait dans sa toute première nouvelle, parue soixante ans plus tôt, mais le crédit de ce récit revient avant tout à Stephen Baxter, qui le cosigne. Au final, à la lecture de ces mille et quelques pages, il ressort et se confirme qu’Arthur C. Clarke ne figurait sans doute pas parmi les meilleurs nouvellistes du domaine, mais qu’il était et demeure encore aujourd’hui l’une des figures majeures de la science-fiction. Philippe BOULIER
Cette intégrale rassemble des nouvelles jusqu’ici dispersées dans 5 recueils, quelques anthologies et une poignée de revues qui ne se trouvaient plus que difficilement chez les libraires d’ancien. Au début de 21ème siècle, les nouvelles d’Arthur Clarke n’étaient plus disponibles en France… L’intégrale propose en plus 27 textes jusqu’ici inédits en France, dont une douzaine de pépites. Les exégètes remarqueront l’absence de 2 novellas, Les montagnes hallucinogènes et Against the fall of night, ainsi que de nouvelles écrites à l’âge du lycée, autant de textes dispensables pour différentes raisons. Tout le meilleur d’Arthur Clarke est là, et même plus. Que les éditions Bragelonne soient louées ! Le volume est considérable car Arthur Clarke est le meilleur écrivain de science-fiction à ce jour. Cette affirmation sera contestée : qu’Arthur Clarke soit le meilleur auteur de science-fiction ; et même que la science-fiction soit considérable... Au minimum, Arthur Clarke est un auteur qui rend la science-fiction considérable. Continuons à agacer le fan en disant qu’Arthur Clarke est un des rares exemples d’authentique science-fiction. Proposition incontestable si on s’en tient à l’idée que dans la science-fiction, il doit y avoir de la science, et de la vraie. Arthur Clarke était respecté dans le milieu scientifique pour sa carrière de vulgarisateur (quasi-inconnue chez nous) et d’agitateur d’idées, son titre de gloire sous cet aspect étant d’avoir le premier énoncé les notions de satellites de télécommunication et d’orbite géostationnaire, ce qui n’est pas rien. Mais à la compétence scientifique Arthur Clarke ajoutait d’autres vertus, et en cela il fut grand. L’humour, l’ironie Cette veine a produit des nouvelles parfois très courtes, qui par conséquent n’ont pas le temps d’ennuyer… Des contes, parfois de pures blagues basées sur des effets cocasses du temps et l’espace (Casanova cosmique), mais pouvant aussi exprimer une idée morale (Campagne publicitaire), ou décrire la première expédition lunaire sous l’angle de l’anecdote (Objectif Lune). Arthur Clarke montre un registre formel étendu : l’histoire à chute, le retournement final, la conférence burlesque, mais aussi le dialogue intérieur, voire le flux de conscience. Cette manière d’Arthur Clarke, notamment l’usage de la chute ou du retournement final, peut aboutir au pathétique, à l’effroi, voire l’épouvante (Les Neuf Milliards de noms de Dieu). Elle s’insinuera même au cœur de nouvelles tout à fait sérieuses : si l’Histoire est tragique, il y a aussi une ironie de l’Histoire (Dernières instructions ; L’étoile)… L’ironie imprègne les seize textes composant Les contes du Cerf Blanc (1957), un de ses chef-d’œuvres (fragmenté ici par la présentation chronologique, mais en revanche donné en complet pour la première fois en France). Dans un pub de Londres, une fois par semaine se retrouvent des chercheurs et des auteurs de science-fiction. Un jour surgit de nulle part Harry Purvis, qui prend l’habitude de raconter les tribulations d’aventuriers de la science connues de lui-seul. On peut comprendre à travers le personnage d’Harry Purvis, qui est après tout une sorte de confrère de l’auteur, que l’humour chez Arthur Clarke était probablement une politesse vis-à-vis de deux publics : le public très critique des scientifiques, à qui il semble dire : « si ce n’est pas vrai, admettez que c’est bien inventé ! » ; et celui des néophytes, reconnaissant qu’on lui épargne le détail des raisonnements en jeu… Toutes les facettes d’Arthur Clarke se retrouvent dans ce recueil, qui démarrant toutes par le regard goguenard des habitués du Cerf blanc sur leur affabulateur préféré, peuvent évoluer vers le drame psychologique, l’exploration des mystères de la matière et du temps, ou les tragédies de l’Histoire. Seule facette absente : l’espace. En 1957, aucun humain n’est encore allé de l’autre côté du ciel… L'aventurier spatial Arthur Clarke fut véritablement engagé aux côtés de la poignée d’humains qui travailla à prendre pied hors de la planète (d’ailleurs la NASA n’a pas été avare en hommages à son égard, de son vivant ou à titre posthume). Bien formé et informé, dans ses textes de fiction consacrés à l’espace il décrit avec précision les conditions de vie d’outre-terre. C’est ainsi que de son propre aveu, vingt à trente pages de calculs furent nécessaires pour préparer une nouvelle qui n’en contiendra aucune trace visible. Précision, et sensibilité : savez-vous que les orages sur Jupiter font un bruit aigu, à cause de la moindre densité de l’atmosphère ? L’espace comme si vous y étiez. Ces textes sont des transpositions, plus ou moins altérées par les rudes conditions de là-haut, de genres de récits éprouvés ici-bas : aventures maritimes, récits de guerre, récits d’explorateurs, western, chroniques, polar ; une investigation par tous les moyens littéraires de la vie dans l’espace. Arthur Clarke aurait pu écrire le film Gravity, mais ce film n’est somme toute qu’une attraction foraine, alors que de la lecture d’Arthur Clarke on ressort souvent grandi, convaincu, comme lui-même l’était, que l’exploration spatiale prélude un nouvel âge de l’humanité. L'historien tragique Arthur Clarke a été un acteur de l’Histoire. En tant qu’officier radar, au cœur de la défense aérienne du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, il fit partie de cette poignée d’individus qui en ont sauvé tant d’autres, sans commune mesure dans l’histoire militaire (pour reprendre Winston Churchill). Une guerre où l’intelligence et l’ingénierie ont été déterminantes, voilà bien un thème clarkien. La Seconde Guerre, c’est aussi la fin d’un monde, plus exactement celle de l’Empire Britannique. « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles », comme déjà l’écrivait Paul Valéry en 1924, après la Première. Peut-être aussi la fin du monde, perspective très concrète contenue dans la bombe atomique. Dans ce monde vacillant, Arthur Clarke envisage l’Histoire à une échelle plus large qu’une catastrophe politique, plus large même qu’une civilisation, c’est à l’échelle de l’espèce que ça se joue. Il y a chez Arthur Clarke un attrait pour les fins, qui nous valent parmi ses textes les plus poignants, où il nous rend sensible l’épaisseur du temps par la mélancolie des choses enfuies dans le ressac des générations, l’immensité du temps et de l’espace. Quelles autres littératures que la science-fiction, et parfois la faërie, héritières de l’épopée, permettent cette hauteur de vue ? Le visiteur (Transience) est le prototype de cette veine, où Arthur Clarke réussit la conjonction de tableaux finement brossés et d’ellipses narratives franchissant des dizaines de millénaires. Arthur Clarke n’a jamais douté que l’instinct de conservation et l’esprit de conquête permettront à l’humanité de franchir les épreuves, fut-ce in extremis. Il a même parfois cédé à la tentation de considérer comme réglés les principaux problèmes de l’humanité et d’échafauder de vagues utopies. Ce ne sont pas des textes passionnants : si le destin de l’humanité est tracé, alors il ne reste rien à raconter, sinon des péripéties secondaires. En témoignent Le Lion de Commarre, ou le roman Les enfants d’Icare (développement de la nouvelle Ange gardien, sauvée – elle – par un peu d’espièglerie). C’est là qu’Arthur Clarke s’est attiré cette avis à double-tranchant : « Plus qu’aucun autre auteur de S-F, Clarke est resté fidèle au rêve de l’enfant qui voit dans la science le salut de l’humanité et dans l’humanité une race de dieux potentiels, voués aux étoiles » (Brian Aldiss). Mais en vérité, il est assez peu question de salut ou de Dieu dans les nouvelles d’Arthur Clarke, ni même de ses avatars, extraterrestres ou autres. Chez Arthur Clarke il est plus question de fascination face au silence éternel des espaces infinis, ou de ce qu’il faut préserver face aux catastrophes de l’Histoire, en somme il est plus question de sacré que de Dieu. Il ne se prenait pas pour un prophète : car finalement les étendues où se déploient l’humanité désormais sont surtout faites de mystères… Le sens du mystère Des forces agissent dans le monde, venues de très loin dans le temps ou l’espace, ou cachées dans la trame du réel. Quelques aventuriers de la science, plus ou moins bien inspirés, en font l’expérience dans ces nouvelles, souvent à leurs dépens. Les portes du mystère ne se franchissent pas si aisément. Hors de la Terre, le mystère s’offre partout au regard, avec les puissances effrayantes et majestueuses du cosmos. Et qui sait, intelligentes… C’est là le grand mystère pour Arthur Clarke, qui à la fin de sa vie espérait encore que vienne la preuve d’une intelligence d’outre-terre. D’autres formes d’intelligence, plus accessibles, ont aussi intéressé Arthur Clarke : les insectes, les créatures marines, les singes ; qui pourraient, un jour, prendre le relais de l’intelligence dans l’univers. L’effroi n’est pas loin, et d’ailleurs Arthur Clarke a commis durant sa jeunesse une parodie de H. P. Lovecraft, le prophète des divinités épouvantables. Il s’est colleté à la vision d’un univers où l’humanité occupe une place dérisoire (« s’il y a quelque dieu ayant l’humanité pour principal souci, il ne doit pas être un dieu très important ») ; où la science rend l’humanité adulte, mais avec tout les dilemmes, la solitude et les angoisses de l’adulte… Comme premier remède à l’angoisse : l’humour. Ainsi qu’un peu de technique : les comètes sont monstrueuses, mais on peut les chevaucher. Néanmoins, gare aux pannes d’ordinateurs. Dès lors, la jugeote devra prendre le relais… Le psychologue, le moraliste Une réserve courante sur l’œuvre d’Arthur Clarke serait son incapacité à rendre vivants ses personnages. Il est vrai qu’il resserre rarement le point de vue sur son personnage, la perspective est plus vaste, omnisciente. La situation domine (néanmoins elle peut être bouleversante). Dans quelques récits, souvent écrits pour le magazine « Playboy », le point de vue se resserre et il se fait très classique, décrivant au plus près la situation et ses protagonistes. Ce sont souvent des situations de tension extrême. Lire « Haine » ou « Transit de la Terre » et continuer à penser qu’Arthur Clarke est un poisson froid est impossible. Certes il n’était pas porté au lyrisme, ou au romantisme si on veut. Question de génération, peut-être. Arthur Clarke est né en 1917 : faire l’apprentissage du monde entre deux guerres mondiales et dans une grande dépression économique peut détourner de l’effusion des sentiments quand la survie collective est en jeu. Mais il était un moraliste. Quelques-unes de ses maximes sont devenues « les lois de Clarke » ; par exemple : « La seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible » (Profiles of the future, recueil d’articles). Le moraliste avait pour sujet l’impact du savoir d’un point de vue philosophique, intellectuel, culturel. Vertu perdue dans la science-fiction : les générations suivantes s’enivreront surtout de prouesses et de cauchemars technologiques. De science en tant que savoir, il ne sera plus tellement question… Rendez-vous avec Arthur Clarke Avant ce recueil, les nouvelles d’Arthur Clarke ont été longtemps indisponibles en France. Son souvenir s’est estompé. On ne l’a plus connu que par ses nombreux romans des dernières années, écrits en collaboration, sans doute pour honorer des contrats qui lui permettaient de financer ses autres activités. Malade, l’énergie n’y était plus. Le cœur non plus, peut-être. Comme il arriva à Voltaire dans son domaine de Ferney, durant les 20 dernières années de sa vie Arthur Clarke s’est surtout consacré au Sri Lanka qui l’avait adopté. De surcroît, la Nouvelle Vague de la SF est passée par là (Robert Silverberg, James Ballard, Philip K. Dick…), surtout inspirée par Franz Kafka ou les surréalistes, suivie par la génération punk (cyber’ et steam’). Ces auteurs ont réfuté autant qu’ils pouvaient la vision du monde d’Arthur Clarke, rationaliste, humaniste, libérale, pour s’attarder sur son ombre portée, « les espaces intérieurs », le déploiement d’une techno-science sans âme, une société disloquée et des individus centrés sur leurs appétits. Pour ceux qui ont commencé à lire de la science-fiction dans les années 90, la déférence à Arthur Clarke est sans doute incompréhensible. Pourtant, il n’a jamais été dépassé. Il serait même heureux qu’il soit simplement rattrapé. On aimerait trouver « une nouvelle littérature idéaliste et bienveillante qui serait moderne non seulement technologiquement mais aussi émotionnellement. Elle montrerait le prix à payer pour résoudre nos problèmes ; elle montrerait l’ordinateur non comme un ennemi ou un dieu, mais comme un outil pour l’humanité. » (Lewis Shiner, 1991 : http://www.lewisshiner.com/liberation/cyberpunk.html ). On aimerait trouver un nouvel Arthur Clarke. Puisse ce monolithe publié par les éditions Bragelonne constituer une nouvelle porte vers les étoiles.
Sylvain FONTAINE |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112066 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |