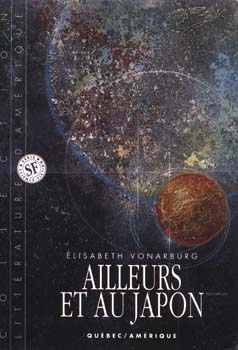 |
L'affaire Sabine Verreault
Une discussion sur les pseudonymes ayant eu lieu dans l’atelier d’écriture que j’anime — leurs motivations et leur utilité — je me suis dit qu’il serait temps de mettre en ligne une bonne fois pour toutes les tenants et aboutissants exacts de “L’affaire Sabine Verreault”, pseudonyme sous lequel j’ai publié trois textes et demi vers le milieu des années 80.
Le texte qui suit est tiré de ma thèse de doctorat en création littéraire, laquelle portait sur ma propre écriture (La Seconde Naissance : entre la Même et l’Autre, Laval, 1987). On est censé rédiger une partie théorique et, pour la pratique, une fiction. J’ai produit quant à moi de la théorie-fiction : une Voyageuse d’un autre univers, devant passer son examen de Voyageuse, qui consiste à passer inaperçue dans une société donnée, se rend sur une Terre ressemblant à la nôtre, où elle choisit comme couverture un personnage d’universitaire faisant une thèse de maîtrise à l’Université Laval sur une obscure auteure de SF morte depuis longtemps, Élisabeth Vonarburg. Nous suivons l’évolution de cette Voyageuse à travers son Journal et les articles qu’elle rédige pour la revue littéraire de l’université ; son histoire à elle n’est pas sans liens secrets avec celle de son sujet, comme elle le comprendra à la fin de son étude.
NB : Les textes évoqués se trouvent tous dans l'anthologie de mes textes Ailleurs et au Japon (Québec-Amérique, 1991), sauf “Le Jeu des coquilles de Nautilus” (in recueil du même nom, Alire, 2003) et “Mané, Thékel, Pharès”, (novella) (dans Espaces Imaginaires IV, collectif, Les Imaginoïdes, Trois-Rivières, 1986.)
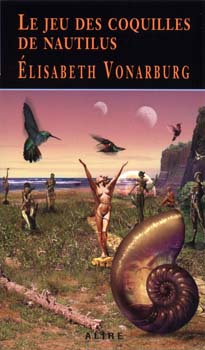 |
C’est toujours dans la fragmentation que se donne à lire l’incommensurable totalité. Aussi est-ce toujours par rapport à une totalité controuvée que nous abordons le fragment ; celui-ci figurant, chaque fois, cette totalité dans sa partie reçue, proclamée, et, en même temps par sa contestation renouvelée de l’Origine, devenant, en se substituant à celle-ci, soi-même origine de toute origine possible, décelable. (Edmond Jabès, Le Livre des Marges)
25 juin 2037
Quelle catastrophe, ce 24 juin ! J’ai passé toutes les festivités à essayer d’échapper à Roger-Marie. Et, finalement, il est assez charmant, le pauvre, bien moins retors et manipulateur qu’il ne veut bien le croire. Mais comment lui expliquer qu’il ne peut être question pour moi de relations approfondies avec les autochtones ? C’est un des pièges classiques — si évident qu’aucun aspirant trans-U, à ma connaissance, n’y a jamais succombé. Plus tard, quand on se fatigue de Voyager, peut-être… Mais ce n’est sûrement pas le genre de monde où je voudrais finir mes jours !
Du coup, me voilà toute déprimée — et me dire que c’est une partie du test n’arrange pas les choses. Ou bien est-ce mon séjour dans l’univers vonarburgien qui commence à m’influencer ? Comme sa Talitha voyageuse, elle était coincée dans cet univers-ci, sans espoir d’en repartir… Je me demande jusqu’à quel point je suis capable d’apprécier véritablement ce que représentaient la vie et la mort pour elle — jusqu’à quel point n’importe lequel d’entre nous trans-U en est capable…
Mais qu’est-ce que j’ai, moi ? N’est-ce pas justement un des buts du voyage-solo, évaluer notre capacité d’adopter la vision existentielle d’êtres pour qui il n’existe à toutes fins pratiques qu’un seul univers ? Est-ce que je serais en train de rater ce test ?
Est-ce que le choix d’une écrivaine de science-fiction, une fabricante d’univers parallèles, serait déjà un signal que j’ai raté…
Mauvaise pente. Arrêter ça. Continuer le travail.
Et d’abord, les univers d’EV sont de moins en moins parallèles, la vie et la fiction semblent y converger de plus en plus. C’est en tout cas ce qui apparaît dans “l’affaire Sabine Verreault”, cette histoire de pseudonyme, en 1985-1986. En se rapprochant de son réel à elle, EV va-t-elle me permettre d’en faire autant et de mieux comprendre en quoi il consiste pour les gens d’ici ?
4 juillet 2037
Fini de rédiger le travail sur Sabine Verreault. J’ai même trouvé le titre sous lequel je pourrais ranger toute l’étude de tous les textes de cette période (1984-1987) : après la construction du Moi féminin, “la construction de l’Autre”. Reynald Duberger, l’austère collègue lacanien de Roger-Marie, va sûrement apprécier. Et un chapitre de plus pour mes archives, avec deux épigraphes, ne lésinons pas :
Mais il est inutile, se dit la pauvre Alice, que je fasse semblant d’être deux ! Alors qu’il me reste à peine assez de moi-même pour faire une seule personne digne de ce nom. (Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles)
L’essence de l’esprit consiste dans un dédoublement, en vertu de quoi il se distingue comme objet et comme sujet. (Hegel)
Entre ces deux citations pourrait en effet s’inscrire l’histoire de Sabine Verreault, pseudonyme sous lequel EV publie trois textes, écrits de 1985 à 1986, “Ailleurs et au Japon”, “Le dormeur dans le cristal” (dans la revue imagine… # 32 et # 35) et “Mané, Thékel, Pharès” (dans le collectif Espaces imaginaires IV). L’“histoire” de Sabine Verreault, c’est en effet comme un texte qu’il faudrait la traiter, puisqu’il s’agit bien d’un acte d’écriture multiforme de la part d’EV. Tout y passe par l’écrit : lettres échangées avec le directeur littéraire de la revue et du collectif qui va publier les textes, lettres aux amis et collègues qui sont dans le secret, circulaire officielle révélant la vérité et, bien entendu, les textes eux-mêmes ainsi que leur genèse. Et non seulement les trois nouvelles citées, mais tous les textes produits pendant cette période.
Ils procèdent tous en effet de “déclencheurs externes”, soit des “consignes d’atelier d’écriture (“Vous rencontrez un obstacle, décrivez-le”), soit des phrases extraites de textes littéraires, point de départ de dé/reconstructions oulipiennes, soit, enfin et surtout, des mots, groupes de mots, lignes, découpés par un ami expérimentateur dans des textes préexistants (poésie, prose fictionnelle…) et qu’il s’agit de sélectionner et de recombiner à sa guise ; ce sont les “machine-à-mots” et “machine-à-récits” de l’écrivain et poète Pierre-André Arcand, qu’EV invite à rencontrer ses étudiants à Chicoutimi lors d’un cours sur les théories littéraires où elle voulait souligner la génération des théories par la pratique.
Elle a tout conservé, à son habitude, de ce qu’elle a écrit pendant la période allant environ du printemps 85 au printemps 86, période couvrant l’essentiel de “Sabine Verreault”, ainsi que deux ateliers d’écriture animés respectivement à l’Université du Québec à Rimouski (mai-juin 85) puis à l’Umiversité du Québec à Chicoutimi (janvier-avril 1986). C’est sans doute en rapport avec le motif de l’auto-appropriation si important dans sa fiction ; mais ici, c’est plutôt comme s’il s’agissait de paragraphes ou de chapitres d’une seule et même histoire. Ce qui permet et facilite l’élaboration de cette “histoire”, c’est d’abord, pourrait-on dire, une injection massive d’Autre, particulièrement dans les poèmes et “Ailleurs et au Japon”…”. Non seulement dans “la forme” des textes (et donc hypothétiquement aussi dans leur “fond”) à cause du matériel aléatoire, mais même dans leur production physique, étrangère aux méthodes habituelles d’EV : d’une part les manipulations des découpures, d’autre part la dactylographie même des textes. En effet, la rédaction d’“Ailleurs et au Japon”…, (qui précède l’élaboration de “Sabine Verreault”, si elle va contribuer à la déclencher) coïncide avec l’acquisition par EV d’un ordinateur, machine-emblème de la modernité par laquelle va bientôt passer toute son écriture. Conjonction intéressante, cette apparition dans sa vie d’un novum technologique et dans sa vie littéraire d’un écrire autrement initié de l’extérieur, par un collègue en écriture…
Si on en croit son Journal, la période 84-85 est une période difficile pour EV. Elle n’a pu mener à bien le roman du “Pays des Mères” qu’elle traîne depuis plus de quatre ans et dont elle a rédigé au moins quatre versions différentes. Parallèlement, la minceur de sa production depuis 1982 (trois nouvelles) ne peut que l’inquiéter… Elle décrit elle-même la genèse de “Sabine Verreault” dans la lettre circulaire où elle révèle le pseudonyme :
[…] Sabine Verreault et Élisabeth Vonarburg sont, à tout prendre, et bien considéré, une seule et même personne.
À trois lettres près : B-O-G, dont on me dit qu’en russe elles forment le mot “Dieu”, ce en quoi j’ai voulu voir à l’époque un signe du destin pour mon entreprise […]
Sabine Verreault est en effet un anagramme partiel du nom de l’auteure. Cette construction elle-même est caractéristique. Par ailleurs, dans “Sabine”, il a y à la fois les Sabines latines dont le rapt cause une guerre entre les hommes, mais dont l’intercession toute féminine apportera la paix ; et un raccourci de “sa binette”, “sa figure” en français familier de l’époque ; quant à “Verreault”, c’est à la fois la fragilité du verre, le verre et l’eau qu’EV utilise ailleurs comme une métaphore de la fiction (contenant/contenu, récit/diégèse), et la première syllabe de VER-ité, qui est aussi phoniquement évoqué par le renvoi à “vero” comme dans le dicton italien “se non e vero e bene trovato” (“si ce n’est pas vrai, c’est quand même bien trouvé”)…
Remarquer aussi qu’un hasard objectif (BOG = Dieu) est explicitement désigné comme un des enclencheurs de l’histoire. Le sens de “bog” en anglais a peut-être aussi contribué à l’égard de l’anagramme : “bog”, c’est un marais, mélange confusionnel et mortel d’eau et de terre ; “to be bogged down”, c’est être coincé…
Je n’ai publié à ce jour que de la science-fiction […] mais je fréquente cependant, par profession et parfois par goût, des auteurs de non-science-fiction, et parmi eux il se trouve des expérimentateurs assez fous, des qui n’hésitent pas à faire le coup du “Et si…” à la littérature littératurante et, par là même, somme toute, se retrouvent assez proches de la science-fiction. […]
Présence, donc, d’Autres qui sont à la fois, comme EV, des écrivains, poseurs de questions, conjectureurs et, à sa différence, n’écrivent pas de science-fiction. Or, “semblable et différent”, c’est le type d’Autre en voie d’élaboration dans la nouvelle “Le Jeu des coquilles de Nautilus”, à la même époque…
L’un de ces compagnons de route occasionnels […] finissait de mettre au point en 1985 une technique fort intéressante pour produire des récits. Au début de l’année, il me demanda de tester son système qui, pour le résumer brièvement, fait appel à une certaine proportion de matériel étranger au scripteur, matériel qui fonctionne à la fois comme guide-arbitraire et comme déclencheur. Je testai donc et produisis ainsi ce que je peux appeler une “histoire” mais un “texte” à coloration onirico-fantastique assez prononcée, un texte-Rorschach qui se trouva être aussi pour moi une plongée étonnamment révélatrice, et assez bouleversante, aux sources de mon imaginaire et de mon écriture. Ce texte, c’est “Ailleurs et au Japon”. Tous les textes que j’ai écrits depuis que j’ai commencé à écrire en 1966, et tous ceux que j’étais alors en train d’écrire, ou de méditer, s’y retrouvaient avec évidence — pour moi.
Distinction à retenir entre “histoire et “texte”, on la rencontrera ailleurs ; elle renvoie essentiellement pour EV à une distinction entre” “fiction” et “matériau personnel non fictionnalisé” : L’auteure insiste sur le phénomène d’intense reconnaissance vécu lors de la production d’“Ailleurs et au Japon”. Le retour “aux sources” est un retour à un matériau personnel, d’une part les thématiques développées dans les textes — la vie d’écrivain ” — et d’autre part l’autobiographie, ce qu’EV appelle toujours avec un accent d’ironie/doute, “la vie réelle”. Ce sera très précisément le passé, des souvenirs d’enfance. Avec ce motif de la mémoire se poursuit donc la reprise des thématiques familières.
Or un ami-lecteur déclara — à ma grande stupeur, comme vous pouvez l’imaginer — que ce texte était fort différent de ce que je faisais habituellement. Il serait intéressant, remarqua-t-il, de soumettre quelque part ce texte sous pseudonyme et de voir la réaction. Mon autre ami fabricant de systèmes d’écriture acquiesça : il était curieux de voir jusqu’à quel point sa technique était susceptible de modifier l’écriture de quelqu’un, la “voix personnelle” telle qu’elle est perçue par autrui.
Ce qui est de façon “bouleversante” du Moi/du Même pour l’auteure se voit donc désigné (par le regard d’Autres masculins…) comme “de l’Autre”. Expérience habituelle des écrivains, mais à laquelle les circonstances semblent avoir rendu EV particulièrement sensible : le couple Même/Autre est en effet en train de subir des métamorphoses importantes dans sa fiction de l’époque.
J’ai toujours eu quelque chose contre les pseudonymes. Lorsque des membres de l’Institution Littéraire les utilisent pour aller s’encanailler dans des genres sur lesquels leur Institution crache — la science-fiction, par exemple. Ou lorsqu’ils font partie de la panoplie du Parfait Petit Écrivain dans la pièce que se jouent certains auteurs. Ou lorsqu’on s’en sert pour dire son opinion sans se mouiller personnellement. Mais il y a des cas de supercherie littéraire qui m’ont toujours fascinée : Romain Gary/Émile Ajar pour en citer un dans la littérature littératurante, et James Tiptree Jr./Racoona /Alice Sheldon dans la science-fiction. Dans l’un et l’autre cas, on semble être en présence d’un certain dédoublement de personnalité. Dans l’un et l’autre cas, il s’agissait aussi en même temps, de façon plus ou moins délibérée et plus ou moins longue, de faire une expérience.
Mouvement simultané de refus et de fascination par rapport au pseudonyme… L’effet de masque ne jouerait plus dans le même registre, en tout cas : il servirait à révéler et non plus à mentir, à ajouter et non à retrancher au Moi — et au Moi littéraire qui se construirait par l’intermédiaire du pseudonyme. Celui-ci devient d’ailleurs une “expérience” — l’argument scientifique fonctionne-t-il ici comme protection, encadrement par le rationnel d’une pulsion qui l’est moins… ? Les deux exemples choisis, Gary/Ajar et Tiptree/Sheldon sont révélateurs à plus d’un titre. La question de l’identité (à la fois personnelle et littéraire) s’y présente sous la forme de la tension ente masculin et féminin — ce qui complète la panoplie thématique vonarburgienne… Enfin, il y a tension entre “littérature littératurante” (néologisme d’EV désignant le point de vue de l’Institution littéraire sur la littérature) et, implicitement, la “paralittérature” et en particulier la science-fiction, puisque Gary/Ajar fait partie de l’une et Tiptree/Sheldon de l’autre.
La période 84-85 m’avait prédisposée à faire des expériences. C’est un moment où je me suis posé des questions assez pénibles sur l’écriture, et sur mon écriture. Pour résumer je ne savais plus très bien où j’en étais ni qui j’étais. Je sentais des changements en cours, mais je n’arrivais ni à les comprendre ni à les contrôler…
Or les écrivains, s’ils n’ont pas l’exclusivité des angoisses existentielles, ont parfois des moyens plus tordus que les autres de se poser des questions et d’y répondre…
Affirmation sans ambages du croisement entre l’être et l’écriture, voire de la fusion entre la vie et l’écriture — la vie étant ce que (se) passe dans l’écriture et vice-versa. Une position assez cohérente chez une écrivaine dont la majeure partie de la thématique essaie d’échapper aux compartimentations en poursuivant la circulation et le mouvement… Mimant donc la démarche de l’auteure elle-même pendant cette période, dans le mouvement qui la fait passer alternativement du vécu à l’écrit, et passer dans cet écrit lui-même d’un texte à l’autre, il faudra donc adopter une approche spiralaire pour aborder “l’histoire de Sabine Verreault” en examinant les textes de Vonarburg.
[S’ensuit un début d’analyse par la narratrice de la nouvelle “Ailleurs et au Japon”.]
Dans […] la lettre à son correspondant Pierre-André Arcand, sur le processus de rédaction d’Ailleurs et au Japon”, EV conclut :
Il resterait une ultime épreuve à ce texte : voir comment un lecteur “innocent” le recevrait.
C’est alors qu’un de ces lecteurs va lui suggérer de présenter quelque part le texte sous pseudonyme et que va naître “Sabine Verreault”. Dans la lettre dont elle accompagne l’envoi de son texte à la direction littéraire d’imagine…, EV campe le personnage ; je souligne les éléments qui correspondent à la vérité telle qu’elle la perçoit (selon son Journal et des entrevues) :
"Professeur de lettres mise en disponibilité, j’ai profité de mes loisirs forcés pour me remettre à des lectures non obligatoires. Inévitablement l’écriture a suivi. Je m’intéresse à la science-fiction depuis longtemps (mes premières tentatives d’adolescente se sont faites dans ce genre), aussi ai-je récidivé.
Je lis les deux revues de science-fiction québécoises depuis assez longtemps pour savoir que seule la vôtre est assez adulte pour envisager la publication d’un texte comme celui que vous trouverez ci-joint ; la seule capable, en tout cas, de m’en donner des commentaires pertinents. Je connais assez la science-fiction pour me rendre compte que ce texte se situe pour le moins dans les marges du genre, mais imagine… a suffisamment donné preuve de sa souplesse et de son réel intérêt à un élargissement des frontières de la science-fiction.
Pour me situer un peu : j’ai trente-deux ans, une maîtrise de lettres classiques (obtenue à Aix-en-Provence, ou je suis allée faire une partie de mes études), et une maîtrise… en philosophie (sur Wittgenstein). En science-fiction, j’apprécie particulièrement Delany, Disch, Dick et Lem (ainsi que Borgès qui, bien sûr, n’est pas “exactement” de la science-fiction), ainsi que Willhelm, Russ et Le Guin. […]"
Elle omet Sturgeon et Simak, disant dans son Journal que ces “deux humanistes de la science-fiction” ne cadrent pas avec le côté cérébral assez poussé dont elle a pensé munir son personnage en lui attribuant un goût pour les “intellectuels” de la science-fiction (et une maîtrise en philosophie !). Sabine Verreault ajoute cependant : “J’ai beaucoup écrit de poésie avant de me mettre à la fiction. Cela transparaît peut-être dans cette dernière.” Elle cite dans une lettre ultérieure ses autres goûts littéraires, qui sont souvent des “intellectuels” parfois théoriciens (Calvino, Pérec, Butor, Burroughs) ; seul Calvino “appartient” réellement aux goûts d’EV ; mais elle cite aussi, tous familiers pour le lecteur des lettres et du Journal :
“Proust, Joyce, Dostoïevski […] Camus (mais pas Sartre) […] et avouerais-je aussi, en vrac, Vian et… Hugo-hélas ? […] les Latino-Américains et le “réalisme magique”, les “petits” romantiques allemands (mais c’étaient les vrais grands, comme en France plus Nerval que Gauthier), et des poètes, bien sûr […] de Hugo-Baudelaire-Blake-Rimbaud dont je refuse de rougir à […] ce cher vieux Valéry […] Éluard, Mallarmé […] Apollinaire, Michaux, St-John Perse, Pierre-Jean Jouve […] Breton) […]”
Elle ne nomme aucun auteur québécois, ce qui risque pourtant de mettre la puce à l’oreille du destinataire ; mais c’est qu’elle s’est fixé des limites, semble-t-il, dans ce jeu de masque/dévoilement… Jeu assez caractéristiquement vonarburgien dans cette composition du personnage par déplacement, scission et renversements : EV a bien envisagé de faire des études en philosophie à son entrée à l’Université, et note souvent pour le regretter son penchant à la cérébralité, voire un certain snobisme intellectuel (scission-rejet, ici). Elle se présente par ailleurs comme une Québécoise ayant fait ses études en France — elle est une Française venue vivre au Québec (renversement). Les mêmes procédés sont à l’œuvre dans les lettres ultérieures où Sabine se dira “laconique” dans les conversations face à face, “trop timide” pour parler au téléphone comme le lui demande le directeur de la revue, et même rendue “catatonique” par les répondeurs automatiques (EV en possède un). Elle dira même qu’elle est heureuse d’être en disponibilité parce que parler en public lui était une torture ; EV se décrit habituellement, au contraire, comme une “verbo-motrice”. (Il apparaît pourtant dans le Journal que la timidité est effectivement un de ses traits, longuement combattu depuis l’adolescence.)
Les lettres n’insistent finalement pas beaucoup, une fois le personnage mis en place, et si elles observent la prudence nécessaire pour assurer l’étanchéité du pseudonyme, il y a çà et là des préoccupations et des phrases vonarburgiennes. Ainsi le “roman qui piétine quelque peu, hélas”, et les soucis féministes ; ou, après un commentaire sur les textes publiés dans imagine… le double-entendre :
Avec quelle arrogance nous jugeons les textes d’autrui ! Mais enfin, la morale, (sinon la beauté) de la chose réside en ce qu’elle fonctionne dans tous les sens […] Ils pourront se faire les dents sur moi aussi !
Ou encore, en réponse à la réticence manifestée par le directeur littéraire d’imagine… à la voir proposer des textes à Solaris, revue rivale :
Ne croyez-vous pas que la plus grande variété de supports soit indispensable dans le milieu encore jeune de la science-fiction au Québec ? Et ceci sans hiérarchisation radicalement qualitative des revues : on y a simplement des projets et des critères différents, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour les auteurs, me semble-t-il ?
Ouverture/circulation et le refus de la hiérarchisation/encadrement : EV traite ces sujets dans un de ses éditoriaux de Solaris à la même époque… Et enfin, après qu’une erreur massive de montage ait interverti plusieurs pages d’“Ailleurs et au Japon” dans imagine… 35 : “hurlement d’agonie de l’auteure coupée en morceaux et frankensteinement reconstituée !”, un phrasé très vonarburgien pour ceux qui connaissent la façon de parler de l’auteure.
Le phénomène de la réception semble avoir joué à plein : rien de tous ces échos et parallèles n’a été perçu comme tel par le destinataire, évidemment. De même, il n’a pas remarqué les convergences thématiques entre l’œuvre d’EV et celle de Verreault. Phénomène de réception là encore, et qui peut s’expliquer comme le postule EV elle-même par le fait que les deux auteures sont des femmes et des universitaires de formation, qui écrivent au Québec de la science-fiction, en puisant au fond thématique commun de celle-ci. Verreault a pourtant cité Rochon et Vonarburg parmi les auteurs québécois de science-fiction qu’elle apprécie. Il peut paraître curieux, surtout à la lecture du dernier texte produit pour imagine… (“Mane, Thékel, Pharès”), que le directeur littéraire de la revue n’ait pas jugé bon d’avertir Verreault des dangers potentiels, pour l’originalité de sa voix, d’une telle appréciation littéraire… En effet, de même que le masque le dispute au dévoilement dans les lettres, le jeu des “influences” semble de plus en plus évident dans “Le dormeur…” et “Mané…” ; les amis dans la confidence feront remarquer à EV la “convergence croissante” des textes avec ceux de Vonarburg.
Elle rappellera avec insistance, ultérieurement, qu’“Ailleurs et au Japon” “n’a pas été écrit par Sabine Verreault”, s’il lui a été ensuite attribué. En fait, Sabine Verreault semble représenter au départ le côté intellectuel/cérébral d’EV, qu’elle juge négatif lorsqu’il n’est pas équilibré par l’affectivité et la sensualité dans le trio classique qu’elle décrit habituellement ainsi : “la tête, le cœur, les tripes”
[La narratrice continue l’analyse d’“Ailleurs et au Japon” et d’autres textes en croisement, “Le dormeur…”, ‘Mané…”, “Les yeux ouverts”, et “La carte du Tendre” ; cette dernière nouvelle, dit-elle :]
[…] a été expressément écrite pour des destinataires bien précis, invités à la lire comme une parabole du processus de communication.
[et elle poursuit] :
8 juillet 2037
Et dans “l’histoire de Sabine Verreault”, on peut considérer que les deux textes réellement écrits par EV sous ce pseudo, (Dormeur et Mané), s’adressent aussi à un destinataire bien particulier, le directeur de la revue imagine… ! Celui-ci, en effet, avait toujours refusé les textes signés Vonarburg, accompagnant son refus de diverses motivations idéologiques et littéraires. Lors d’un débat sur les critères littéraires dans l’édition de science-fiction, en 1986, pendant un congrès québécois sur la science-fiction, il rend même publiques ces motivations :
[…] il y a un genre de science-fiction, un type de science-fiction — et ça, ce sont des goûts littéraires et des goûts politiques — que je considère comme moins intéressant que d’autres […] Quel type de science-fiction ? C’est une science-fiction qui est… mythologique, ou qui tend à l’être. Qui utilise énormément les mythes et d’une façon, je dirais, “apprise”, c’est-à-dire que, si vous n’avez pas la connaissance de ces mythes-là, si vous ne les avez pas appris en classe, si vous n’avez pas envie d’aller chercher dans des dictionnaires de mythologie, vous pouvez difficilement comprendre le texte […] Je pense que la science-fiction — comme genre ; c’est une hypothèse — n’a que peu à voir avec la mythologie, très-très peu. Elle peut être critique des mythes, mais n’est certainement pas réactivation des mythes anciens. Surtout pas des mythes de Janus etc. C’est pourquoi je crois que si j’ai refusé “Janus”, je ne le présentais pas du tout comme la raison fondamentale… […] enfin, c’est à rapprocher des mythes justement. À partir du moment où tu fais intervenir des rêves que tu ne rends pas d’une façon fictionnelle, c’est-à-dire que c’est manifestement un rêve… Tu as dit une fois que tu rationalisais tes rêves le matin en te réveillant parce que c’était tout frais dans ton esprit. Il y a des cas où c’est tellement flagrant que c’est ce procédé-là que moi, ça me gêne. Et dans ce sens-là, j’ai toujours une réticence à publier des choses qui, — à mon avis à moi, attention — ne me paraissent pas… abouties. La mise en forme, si tu veux, la mise… en quoi, en fiction ? n’est pas suffisante (Carfax # 28, 1987).
EV a beau jeu alors de lui rappeler que “Janus” n’est précisément pas une de ces nouvelles dont le point de départ est un rêve…
Les lettres et les quelques confidences du Journal pendant la période Sabine Verreault semblent indiquer qu’EV n’a pas vraiment conscience d’entretenir un dialogue masqué à propos de son écriture (et de son écriture de science-fiction) avec le directeur d’imagine… Par sa résistance (aux textes signés Vonarburg), celui-ci représente pourtant bien l’Autre tel qu’elle le définit elle-même ! Et il devient ainsi l’ “Opérateur” privilégié d’une expérience de lecture en quelque sorte parallèle à celle présentée dans “La carte du Tendre” ! Mais s’il est invité à opérer le déchiffrement de Vonarburg dans Verreault, il est aussi le “Sujet” (comme dans “La carte…”) de la lecture au second degré que Vonarburg-Verreault opère à son tour, tout en en ayant conscience ou non, sur ce déchiffrement de ses textes… Interrogation sur l’importance réciproque du rêve et de la fiction, toujours, et aussi du mythe. Science-fiction et mythe constituent un couple négatif pour le directeur d’imagine… alors que, […] EV a toujours défendu le mythe avec beaucoup d’énergie…
9 juillet 2037
Dans l’optique d’un dialogue critique masqué entre EV et le directeur d’imagine…, “Le dormeur dans le cristal” prend un relief assez particulier. C’est d’ailleurs à propos de cette nouvelle que l’échange des lettres entre “Sabine” et son interlocuteur est le plus “littéraire”. Et c'est cette nouvelle qu’EV désigne dans son Journal et ses entrevues comme “la seule véritablement écrite par Sabine Verreault”, puisqu’elle considère “Mané…” comme “tellement du Vonarburg que ça frise la parodie” (Journal, octobre 86) ; avis d’ailleurs apparemment partagé par ses lecteurs-tests qui lui avaient vivement déconseillé d’envoyer ce texte à imagine…, le trouvant trop “transparent”. (Mais le phénomène de perception continue à jouer à plein, puisque la revue accueille le texte avec un enthousiasme marqué.)
Ayant accepté “Ailleurs et au Japon” (à la grande stupeur d’EV qui le considérait comme bien trop “onirico-fantastique” pour imagine…) le destinataire demande à Verreault d’écrire un texte de science-fiction “plus canonique”[…] classique”, qui sera publié avant “Ailleurs et au Japon” afin d’éviter à l’auteure d’être cataloguée “expérimentaliste intello” par les lecteurs de la revue. Verreault acquiesce à cette stratégie non sans avoir manifesté une certaine perplexité sur ce que peut être un “texte canonique de science-fiction”. EV, elle, s’installe devant son clavier et, en une journée, écrit “Le dormeur dans le cristal”. Journal, lettres et entrevue de 87 indiquent que c’est avec ce texte qu’elle a vraiment pris conscience de l’aspect possiblement “ludique” de l’écriture pour elle — et aussi que, pour la première fois, elle produit vraiment un texte de SF sur commande, elle qui s’en croyait incapable. C’est dans ce cadre sans doute qu’il faut examiner cette nouvelle, écriture ludique d’un texte de commande, mais, en même temps, de façon semi-consciente, réflexion d’EV sur son écriture, sur la science-fiction, et sur sa science-fiction : onirisme, place relative du mythe, degré de la fictionnalisation…
Dans son Journal, à à la fin cette journée d’écriture, elle remarque laconiquement : “Parlez-moi d’autophagie !” En effet, non seulement le motif vient-il de Tyranaël, mais encore le titre choisi est à la fois celui d’un poème écrit en 1974 et celui de la chanson décalque qu’en a tirée ensuite EV.
[La narratrice analyse “Le dormeur…”]
Ce texte semblerait donc constituer une totale régression à un stade psychique très antérieur même à Tyranaël. Mais […] l’exploration systématique de la négativité jusqu’alors refoulée ou euphémisée constituerait au contraire une (re)conquête positive pour EV. C’est pourtant sous le masque de Sabine Verreault qu’elle s’y livre d’abord… Elle aurait donc bien conçu celle-ci comme une sélection/exagération de certaines de ses tendances […] Sabine Verreault serait vraiment ici, et sur la mode de la schize, le “double” de Vonarburg, son “ombre”, dirait Jung. Ce qui explique sans doute la réponse faite à un commentateur estimant que l’écrivaine Verreault valait “deux Vonarburg” : “Non, elle en vaut une demie, et j’avais vraiment hâte de la récupérer.” (Journal, mars 87) ; i.e. de mettre fin au “dédoublement de personnalité” dont elle parle dans la lettre circulaire où elle révèle son pseudonyme.
 |
Enfin, pour mettre un point final à toute cette histoire, une courte préface à la novella “Mourir, un peu” (le “demi”-texte de Sabine Verreault évoqué en introduction, (publié initialement dans Sous des Soleils étrangers, collectif de SF québécoise, éditions Ianus, Laval, 1989), et dont les auteures sont indiquées comme étant “Élisabeth Vonarburg et Sabine Verreault”, déclare ceci :
Cette nouvelle est une grande première pour Sabine et pour moi : nous n’éprouvons plus de besoin de nous cacher l’une derrière l’autre et réciproquement. Nous savons maintenant mieux qui nous sommes — et que nous nous complétons assez bien, ma foi. Sabine fait davantage confiance au hasard des mots et part plus facilement avec eux à l’aventure : c’est elle qui m’a fait convaincue de faire appel une fois de plus à la technique dite “de la shreddeuse” (des lignes découpées au hasard dans divers textes et qu’il faut rabouter en racontant une histoire avec, à la jonction de leur fantaisie et de la vôtre). C’est qu’elle est plus désinvolte, aussi, avec les écrous et les boulons des histoires (pas folle, elle sait que je repasserai derrière pour les resserrer, voire en ajouter !) Plus préoccupée de texte que d’intrigue, elle a pourtant moins de complexes que moi à l’égard de certains types d’écriture plus traditionnels, permettant des enchaînements plus expéditifs… Mais en fait, si je n’étais pas là pour la harceler, elle laisserait complètement tomber le récit et se contenterait de juxtaposer de simples paragraphes sculptés en lacis comme ces défenses d’éléphant hindoues… Elle se soucie moins que moi des personnages qu’elle sème dans ses lignes, plus attentive à leurs visions qu’à leur rédemption. Je ne suis même pas sûre qu’elle ait beaucoup d’intérêt pour eux — c'est à moi qu’elle laisse le soin de les connaître.
Et surtout, Sabine a une grande qualité à mes yeux : comme elle est pathologiquement timide, elle me laisse toujours le dernier mot.
|