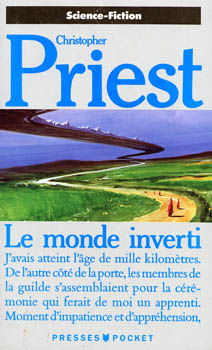|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Le Monde inverti
Christopher PRIEST Titre original : Inverted World, 1974 Première parution : London, Royaume-Uni : Faber & Faber, mai 1974 ISFDB Traduction de Bruno MARTIN Illustration de Wojtek SIUDMAK POCKET (Paris, France), coll. Science-Fiction / Fantasy  n° 5279 n° 5279  Dépôt légal : janvier 1992 Roman, 320 pages, catégorie / prix : 7 ISBN : 2-266-04621-7 ✅ Genre : Science-Fiction
Autres éditions
CALMANN-LÉVY, 1975 GALLIMARD, 2002, 2004, 2016, 2022, 2024 J'AI LU, 1976, 1977, 1987 POCKET, 1988, 1997 Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org
Quatrième de couverture
Helward Manu avait atteint l'âge de mille kilomètres. Il allait entrer dans la prestigieuse guilde des Topographes du Futur. Au prix d'un serment terrible : il ne révélerait jamais ce qu'il pourrait voir du monde hors de la Cité Terre. A quoi servait la Traction ? Et la Pose des Voies ? Et la Construction des Fonts ? Helward le sut dès sa première sortie. Lentement, difficilement, la Cité progressait sur le sol inconnu d'une planète effrayante. Pour survivre, il fallait se rapprocher d'un point situé dans le Futur : l'Optimum. Et l'Optimum se dérobait sans cesse. Impossible de s'écarter du chemin : la réalité physique se disloquait aussitôt. Un ravin se refermait, une montagne s'élargissait ou s'aplanissait, les êtres vivants eux-mêmes étaient soumis à des métamorphoses monstrueuses. Dans cet univers-là, le temps se comptait en kilomètres. Et il n'arrêtait pas. Christopher Priest, né en 1943, publie de la S.-F. depuis 1966. Beaucoup voient en lui le plus ambitieux et le plus brillant des écrivains anglais de sa génération. Sa spécialité : les univers de rêve qui sont pour le rêveur l'unique réalité. Un référendum récent auprès d'un panel de personnalités françaises a désigné les meilleurs livres de S.-F. de tous les temps : Le monde inverti a été classé deuxième. Critiques des autres éditions ou de la série
« J'avais atteint l'âge de mille kilomètres. » La fameuse première phrase 1 de ce roman extraordinaire propulse d'emblée le lecteur dans un univers dense, cohérent et mystérieux. Le Monde inverti, qui date de 1974, reste encore à ce jour l'œuvre la plus célèbre de Christopher Priest, et l'on comprend aisément pourquoi ! Dans la droite lignée de Philip K. Dick, Priest construit un roman captivant sur la perception du réel, qui n'est pas sans rappeler les tableaux d'un Dali. Surréaliste ? Indubitablement. Mais ce surréalisme, si ahurissant qu'il soit, n'en demeure pas moins attaché à une volonté farouche de rester ancré dans un cadre réaliste. Jugez-en donc. Imaginez une ville roulante. Une ville en bois, condamnée à être tractée chaque jour sur des rails sous un soleil étrange et brûlant, à la poursuite d'un optimum, point géographique sans cesse en mouvement au-delà duquel le monde subi d'aberrantes distorsions. Cette ville est la Cité Terre, en hommage à la planète-mère. Helward Mann, l'un de ses habitants, devient membre de la Guilde du Futur. Son rôle ? Partir au nord de la ville (le « futur »), en éclaireur, pour déterminer le meilleur tracé de la cité pour rejoindre l'optimum. Or l'extérieur est un monde hostile, peuplé de paysans hispanophones affamés, mais surtout dangereux par sa nature même. Helward, pour s'acquitter de sa mission, doit en effet s'éloigner de la ville, gagner les terres où l'espace-temps s'étire ou se contracte, défiant toute logique. Helward va soudain être confronté à une énigme insoluble et contraint à envisager l'impensable... Dans Le Monde inverti, la « distorsion du réel » n'est pas un vain concept ! Vertigineuse illustration de la pensée phénoménologique, le roman est admirablement construit. Les changements de points de vue (tantôt à la première personne, tantôt à la troisième) opèrent un décalage à première vue injustifié mais qui prend tout son sens à mesure que la vérité se dévoile. Le talent de Priest est de masquer l'enjeu réel par un autre, en l'occurrence la course à l'optimum, qui génère nombre de péripéties haletantes. Lorsque éclate alors enfin cette vérité que l'on osait à peine envisager (et que nous tairons ici, évidemment !), le lecteur reste ébahi et c'est d'un œil méfiant, voire soupçonneux, qu'il contemple le monde réel. Réel, vraiment ? Notes : 1. Première phrase... dans cette nouvelle édition. Denis Guiot nous signale que le prologue du Monde inverti — l'un des récits les plus originaux et les plus beaux de toute l'histoire de la SF — a disparu à l'occasion de la réédition chez Folio SF du roman de Christopher Priest ! Il s'appuie sur la réédition Pocket de 1988 pour nous livrer cette information et nous la confirmons au vu de l'édition J'ai lu de 1976. Autre mystère : la traduction a été fortement révisée, sans que cela soit mentionné. (N.D.L.R.) Olivier NOËL
Le monde inverti, c'est l'histoire de la Ville : une ville se composant d'une grappe d'immeubles pour la plupart construits en bois et avançant sur des rails comme un gros convoi spécial. Pourquoi doit-elle sans arrêt progresser ? Qu'est-ce qui motive cette perpétuelle fuite en avant ? Les habitants de la Ville l'ignorent. Seuls les membres des Guildes, parce qu'ils travaillent à l'extérieur et font progresser la ville, connaissent les véritables raisons de ce mouvement incontournable. L'ennui, c'est que les manœuvres qui travaillent à la pose et au retrait des rails, de pauvres gens recrutés là où passe la Ville, se rebellent et attaquent leur employeur. L'autre ennui, c'est qu'à l'intérieur de la Ville grandit un mouvement, les Terminateurs, dont le but est de stopper définitivement la Ville et qui n'hésite pas à commettre quelques sabotages. Le dernier ennui, enfin, sans doute le plus lourd de conséquences, c'est que les habitants de la Ville, y compris les membres des Guildes et les Navigateurs, ont une perception de monde complètement fausse. Pour eux, il y a l'Optimum. Au nord de ce point, le salut. Au sud, la destruction. Tout cela n'est bien sûr qu'une illusion. Avec cette œuvre, Christopher Priest a écrit quelque chose de joliment original. Il n'y a pas à s'étonner si ce roman est considéré comme l'un des classiques du genre, relativement récent du reste puisqu'il est paru dans les années soixante-dix. L'idée de cette Ville qui se déplace en permanence vers un avenir inconnu, dont l'âge se compte en kilomètres, et qui se heurte finalement à la mer avant que la vérité n'éclate, vaut déjà son pesant d'imagination. A cela s'ajoutent d'autres concepts passionnants : celui d'un monde hyperbolique, en constante désagrégation au sud et qui tendrait vers une stabilité quasiment définitive au nord. Celui, aussi, des fenêtres de translatération, en quelque sorte des arrivées naturelles d'énergie en puissance se déplaçant à la surface de la Terre en respectant une trajectoire circulaire. C'est complexe mais pas difficile à lire. Ceux qui ne connaissent pas ce livre ne devraient pas laisser passer cette réédition. Éric SANVOISIN
Il y a une première erreur à ne pas commettre, c'est de prendre ce titre à son sens évident, en donnant à « inverti » son sens moderne le plus courant, et attendre la description d'une société où le FHAR et les « Gouines Rouges » auraient triomphé, et où les mœurs seraient fondées sur l'inversion sexuelle — ce qui ne serait pas un sujet d'anticipation si farfelu que ça depuis que Malthus (n'en déplaise à Alfred Sauvy) est réhabilité, et que l'on doit (n'en déplaise à Michel Debré) se demander comment limiter la croissance démographique autrement que par la violence.. Mais il s'agit ici de tout autre chose : Bruno Martin a choisi de traduire « inverted » par « inverti » au lieu d' « inversé », peut-être pour jouer justement sur la rareté de cet autre sens d' « inverti », propre aux scientifiques : inversion du sucre, inversion du relief, inversion d'un courant électrique, inversion d'une fonction. Cette première inversion de point de vue n'est pas la dernière que l'on fait au cours de la lecture. Il y a un prologue centré sur Elisabeth Khan, infirmière dans un village sous-développé ; une première partie narrée par Helmuth Mann, jeune membre d'une curieuse cité mobile où l'on compte le temps et l'âge en kilomètres, et que dominent des Guildes soumises au secret et tirant leur raison d'être de l'obligation d'avancer toujours ; une deuxième partie où la découverte du monda étrange au sud de la cité par le même personnage est racontée à la troisième personne cette fois, peut-être pour que le lecteur ne puisse mettre sur le compte d'une aberration mentale du seul Helmuth Mann les étranges altérations de la durée, des formes et des forces qu'il constate et subit ; une troisième partie où, à la première personne de nouveau, le jeune homme expose sa recherche d'une explication et, renié par sa jeune femme, adopte pleinement le point de vue officiel sur la nécessité de suivre toujours l'Optimum, seul point où régnent les mêmes conditions que sur Terre ; une quatrième partie où la même jeune femme que dans le prologue (ce qui justifie enfin ce dernier) rencontre Helmuth, et prend la place d'une indigène « transférée » pour pénétrer dans la Cité et en percer le secret ; une cinquième partie enfin, où on a sur la révélation d'Elisabeth l'opinion d'Helmuth, qui refuse de la croire. Parallèlement, l'impression du lecteur s'inverse sans cesse. Il croit d'abord à une satire du colonialisme (exploitation de la main-d'œuvre indigène et traite des... non-blanches) et de la civilisation fondée sur une Idéologie (cet Optimum qu'il faut suivre, c'est un peu la colonne de feu envoyée par Jéhovah pour obliger les Hébreux à traverser le désert, un peu le mythe du progrès et de la croissance continue dont nous faisons le grand commandement de notre dieu Mammon). Puis la croyance & l'Optimum et le système qui en découlent semblent bel et bien justifiés par les conditions objectives, et l'on se dit alors que Christopher Priest a tout simplement rivalisé avec succès avec les grands « créateurs » de planètes extraordinaires — Hal Clement et sa Mesklin aux énormes variations de gravité, Fredric Brown et sa Placet qui décrit un 8 autour de deux soleils dont un d'antimatière et rattrape parfois sa propre image, Larry Niven et son anneau-monde — et, avec l'aide d'un ordinateur, a su concevoir une cosmographie fondée sur l'hyperbole, courbe d'une équation où une valeur est l'inverse de l'autre (y=1/x). Enfin, ce modèle mathématique se trouve à son tour justifié par une explication physique (champ de force) et par une mise en situation dans notre contexte historique, économique et social (épuisement des sources d'énergie classiques, d'où Catastrophe et recherche d'une force nouvelle). Mais, alors que fantaisie et raison semblent réconciliées — ce qui est le propre de la science-fiction — de nombreux faits s'avèrent irréductibles à l'explication enfin découverte : c'est le héros lui-même qui les évoque. Suprême affirmation de cette « relativité généralisée » où nous sommes plongés depuis le début du récit ? Je dirais plutôt pour ma part — et c'est le seul reproche que je ferais à un livre admirable par l'originalité de la conception, la précision de la mécanique, et l'habileté avec laquelle le suspense est maintenu du début à la fin — malencontreuse rechute finale dans le fantastique, avec lequel la science-fiction peut évidemment jouer — et ne s'en prive pas — mais qu'elle doit en fin de compte exorciser si elle veut rester elle-même. George W. BARLOW Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes
Jacques Sadoul : Anthologie de la littérature de science-fiction (liste parue en 1981) Denis Guiot & Jean-Pierre Andrevon & George W. Barlow : Le Monde de la science-fiction (liste parue en 1987) Albin Michel : La Bibliothèque idéale de SF (liste parue en 1988) Jean-Bernard Oms : Top 100 Carnage Mondain (liste parue en 1989) Lorris Murail : Les Maîtres de la science-fiction (liste parue en 1993) Stan Barets : Le Science-Fictionnaire - 2 (liste parue en 1994) Denis Guiot, Stéphane Nicot & Alain Laurie : Dictionnaire de la science-fiction (liste parue en 1998) Association Infini : Infini (1 - liste primaire) (liste parue en 1998) Francis Valéry : Passeport pour les étoiles (liste parue en 2000) Jean-Pierre Fontana : Sondage Fontana - Science-fiction (liste parue en 2002) |
| Dans la nooSFere : 87325 livres, 112277 photos de couvertures, 83760 quatrièmes. |
| 10830 critiques, 47169 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |