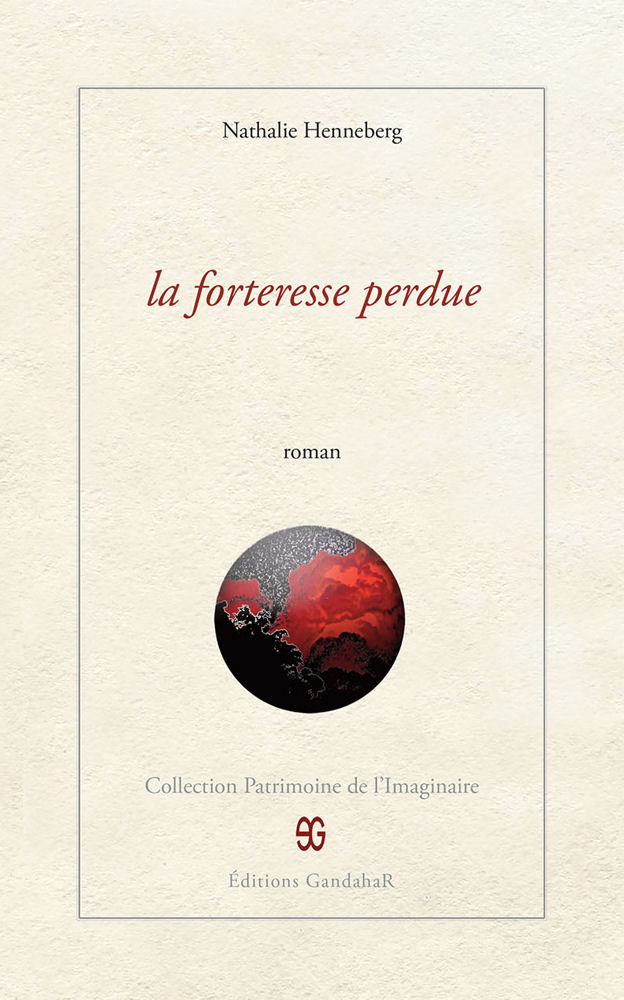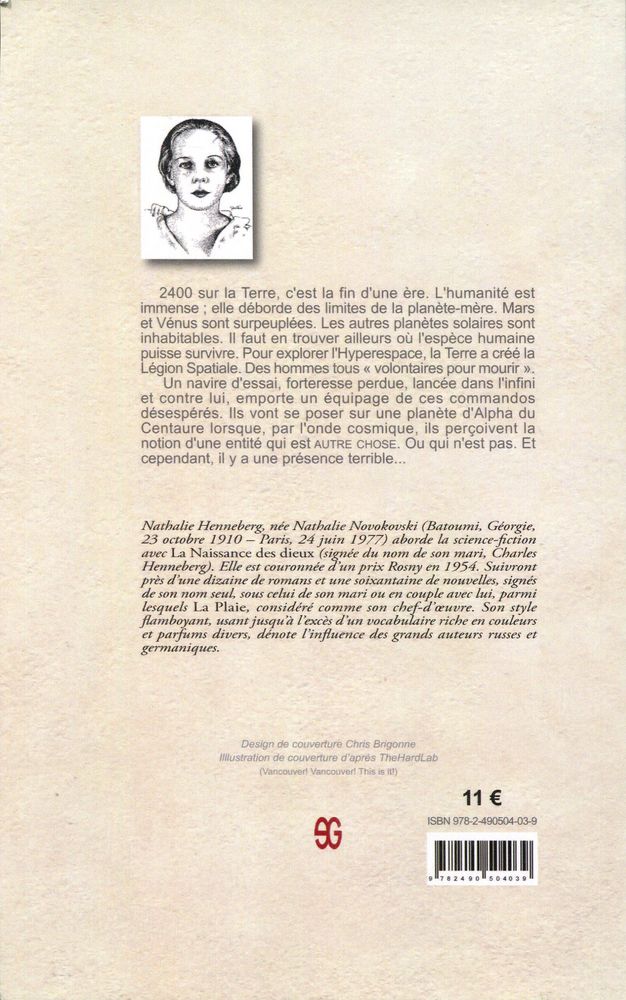|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
 Fiche livre
Fiche livre |
Connexion adhérent |
|
La Forteresse perdue
Nathalie HENNEBERG Première parution : Paris, France : Le Rayon fantastique n° 94, 1er trimestre 1962 Illustration de TheHardLab GANDAHAR (Clermont-Ferrand, France), coll. Patrimoine de l'Imaginaire  n° 2 n° 2  Dépôt légal : 3ème trimestre 2018, Achevé d'imprimer : 15 mars 2019 Réédition Roman, 228 pages, catégorie / prix : 11 € ISBN : 978-2-490504-03-9 Format : 13,5 x 21,5 cm✅ Genre : Science-Fiction
Quatrième de couverture
2400 sur la Terre, c’est la fin d'une ère. L'humanité est immense ; elle déborde des limites de la planète-mère. Mars et Vénus sont surpeuplées. Les autres planètes solaires sont inhabitables. Il faut en trouver ailleurs où l'espèce humaine puisse survivre. Pour explorer l'Hyperespace, la Terre a créé la Légion Spatiale. Des hommes tous « volontaires pour mourir ». Nathalie Henneberg, née Nathalie Novokovski (Batoumi, Géorgie, 23 octobre 1910 — Paris, 24 juin 1977) aborde la science-fiction avec La Naissance des dieux (signée du nom de son mari, Charles Henneberg). Elle est couronnée d’un prix Rosny en 1954. Suivront près d'une dizaine de romans et une soixantaine de nouvelles, signés de son nom seul, sous celui de son mari ou en couple avec lui, parmi lesquels La Plaie, considéré comme son chef-d’œuvre. Son style flamboyant, usant jusqu’à l’excès d’un vocabulaire riche en couleurs et parfums divers, dénote l’influence des grands auteurs russes et germaniques.
Sommaire
Afficher les différentes éditions des textes1 - Didier REBOUSSIN, Préface, pages 7 à 9, préface
Critiques
[Focus Nathalie Henneberg : - La Forteresse perdue - Gandahar - Les Dieux verts - Callidor - Le Dieu foudroyé - L'Atalante]
Par un curieux hasard calendaire, trois rééditions de Nathalie Henneberg nous arrivent en même temps ou presque. Pour une auteure passablement oubliée, voilà qui méritait bien un « focus » bifrostien… La Forteresse perdue n’avait jamais été réédité depuis sa parution originale au « Rayon Fantastique » en 1962. À sa lecture, on comprend vite pourquoi, tant cette dernière s’avère pénible. Une bien mauvaise surprise, en somme, d’autant que mes lectures précédentes de l’auteure m’avaient plutôt laissé de bons souvenirs… Dans sa préface, Didier Reboussin écrit : « Comme toujours chez Nathalie Henneberg, il faut oublier l’aspect rationnel des choses (…) où le monde futuriste qu’elle dépeint n’a rien de plausible. » Nous voilà prévenus… Donc, une expédition de la Légion de l’Espace lancée vers Alpha du Centaure a abordé un monde nommé Isis ouvert sur plusieurs dimensions. Elle y a établi un fortin et s’y accroche avec la rage du désespoir. Mais Isis sert aussi de tête de pont à des créatures d’énergie vampiriques se manifestant sous l’aspect de flammes violettes qui entendent envahir la Terre pour se repaître des êtres humains… Le roman s’articule autour de trois personnages. Alix Orlova — une projection transparente de l’auteure —, Arnold de Held — celle de son mari, Charles —, et enfin Ruy Béarn-Léans, traitre façonné dès le début par les flammes violettes qui n’est pas sans rappeler le héros du Sabre de l’Islam. On y retrouve les figures d’amants tragiques que séparent les valeurs sacrées du devoir auxquels ils se sacrifient. La Forteresse perdue offre une dimension largement autobiographique de la vie des époux Henneberg au Proche Orient au début des années 40, à travers une évocation de la défense acharnée de Palmyre (Syrie) par une compagnie de la Légion Étrangère face à des troupes anglaises largement supérieures tant en nombre qu’en matériel. Le récit se veut poétique, épique, haut en couleur. Il n’en est rien. Les mots, précieux souvent, s’alignent mais peinent à faire jaillir des images ; un défaut de cohérence rend l’histoire difficile à suivre, et il faut passer la moitié de ce « fort Alamo stellaire » pour percevoir une amélioration sensible qui ne parvient toutefois pas à sauver cet ensemble brouillon. Dommage. Avec Les Dieux verts rien ne change, sauf que cette fois, ça marche… Tout ce qui apparaissait confus dans La Forteresse perdue devient limpide, évident. La poésie prend corps et les images jaillissent à toutes les pages, souvent sublimes. J’avais un excellent souvenir des Dieux verts, mais après la cruelle déception de La Forteresse perdue, le pire n’était pas à exclure. Or, dès les premières pages, je me voyais rassuré et embarqué, entrainé au plus profond de la nuit d’émeraude avec des personnages plus grands que nature. On plonge dans un univers flamboyant de tous les tons du vert, un tourbillon de merveilles créées par une styliste hors pair dont on ne trouvera guère l’équivalent que chez Samuel R. Delany. Plutôt que de s’empiler, les mots chantent et se répondent en canon, engendrant la plus gracieuse des polyphonies. Il y a 2000 ans, la Terre, alors à son apogée, maîtresse d’un empire stellaire, s’est soudain vue frappée par un terrible cataclysme qui n’a laissé que de rares survivants tout en l’isolant du cosmos. La civilisation humaine s’est effondrée tandis que pour les plantes et les insectes, l’heure de la revanche sonnait. Depuis, l’homme défend les ruines de son empire avec mollesse, s’abandonnant aux rêves, à la décadence, laissant les rênes aux végétaux et copiant les insectes, notamment dans leurs mœurs cruelles. Ainsi, la loi impose-t-elle aux derniers mâles solaires, de race pure, de mourir après le vol nuptial… l’enjeu pour les plantes étant d’en accélérer la disparition avant que l’isolement de la Terre ne prenne fin. En dépit de son amour pour la petite reine Atléna, Argo, le suffète des mers, refuse de se plier à cette loi inique et se rebelle. Comme d’habitude chez Henneberg, leur amour est frappé du sceau de la tragédie. Tandis qu’Atléna se voit chargée de défendre ce qui reste de l’empire, Argo se retrouve à la tête d’une horde de monstres et de mutants avec laquelle il entend libérer A-Atlan du joug des plantes intelligentes et rendre à l’humanité sa splendeur passée. Les Dieux verts, qui en est à sa quatrième édition, offre toute la panoplie des thèmes chers à Henneberg. L’amour rendu tragique par un implacable destin qui dresse les amants l’un contre l’autre, chacun mu par un sens du devoir infrangible. Le combat final, apocalyptique, fratricide, qui toujours évoque ceux de Palmyre, où l’ennemi véritable se dissimule en arrière-plan. D’innombrables plantes sont ici nommées par leur nom scientifique, ce qui aurait eu tôt fait de sombrer dans le dernier lourdingue, or il n’en est rien. Une riche poésie émerge de toutes les nombreuses descriptions où l’auteure se joue de mots rares pour les palais, les femmes-insectes souvent comparées à des phalènes ou à des orchidées… Imaginez deux parties d’échecs. Même ouverture. Même variante. L’une perdue, l’autre gagnée. Difficile de concevoir que deux romans aussi semblables parviennent à des résultats aussi opposés. Les Dieux Verts est un pur chef-d’œuvre ; La Forteresse perdue pour ainsi dire illisible. Entre ces deux extrémités, Le Dieu foudroyé occupe une place médiane. Ce troisième volume, qui vient compléter La Plaie, où Nathalie Henneberg évoquait l’exode vécu enfant avec les derniers Russes Blancs de l’armée de Wrangel, point final de la révolution bolchévique, n’en a pas l’envergure. Le souffle épique s’est tari. Initialement publié chez Albin Michel un an avant sa mort (en 1977), ce roman est le chant du cygne d’une auteure désireuse de ne pas laisser son grand œuvre inachevé. La flamme vacille, comme la vie d’Henneberg elle-même. Peut-être a-t-elle trop attendu… Nathalie Henneberg a toujours fonctionné à l’inspiration, elle n’a jamais été un écrivain de métier pouvant sur le tard compter sur le savoir-faire acquis pour compenser une moindre activité créatrice. En dépit de quelques morceaux de bravoure disséminés ici ou là, jamais Le Dieu foudroyé n’atteindra à l’éblouissement des Dieux verts ni à l’ampleur de La Plaie. Le talent est un tigre furieux qui emporte tout dans une étourdissante chevauchée, laissant le lecteur tout ébahi ; mais à juste le tenir par la queue, il se retourne et lacère de ses crocs et ses griffes. Plus grand est le talent, plus sauvage le tigre. Ainsi le tigre du Dieu foudroyé était-il un vieil animal déjà bien fatigué. Jean-Pierre LION Critiques des autres éditions ou de la série
Ce nouveau Henneberg est plus pur, plus dépouillé encore que les précédents. À la quête visionnaire qui l’anime, tous les éléments rapportés, condition obligée – mais quelquefois importune – de l’œuvre littéraire, sont plus ou moins sacrifiés : la construction dramatique (chargée d’assembler sans dommages excessifs une série de scènes paroxystiques) n’est pas des plus solides ; plus d’une vision trop personnelle sans doute, parvient difficilement à s’exprimer ; il n’est pas jusqu’à la rédaction elle-même (pourtant un des points forts de Nathalie Henneberg) qui ne souffre à l’occasion d’un goût trop marqué pour la syntaxe passionnelle, dont les phrases en suspens et les virgules démesurément lourdes de sens ont dû perdre plus d’un typographe avant de fasciner leurs lecteurs. Pourtant ces négligences paraissent secondaires devant les vertus qui font de ce roman, sinon un chef-d’œuvre (car le romantisme de Nathalie Henneberg s’accommode mal de froide perfection), du moins un livre hors de pair, sentinelle avancée de la littérature au pays du magnifique et de l’exceptionnel. Les familiers de l’auteur retrouveront ici l’état de grâce bien connu, l’extase qui anime la prose hennebergienne. Les visions se pressent à longueur de page, fleurissant le récit de leurs chimériques prestiges. Il y en a tant qu’elles ne sont pas toutes également belles, il s’en faut : « La forteresse perdue » recèle plus d’un coucher de soleil banalement parnassien, et telle description de ville, conventionnelle à rendre jaloux les décorateurs de l’Opéra-Comique, nous plonge dans un malaise dont seul nous tire l’aveu, fait par l’auteur, d’un sentiment semblable au nôtre (Page 103). À côté de cela, les réussites sont légion, et nous ne résistons pas au plaisir d’en citer quelques-unes – celle-ci par exemple : « C’était un monde artificiel, une nuit sans fraîcheur, une vague stérile. D’étranges formes se mouvaient sur les rives. Ruy sentit un glissement soyeux, on eût dit d’un poulpe ou d’une énorme araignée, cherchant sa proie dans l’ombre. Des filaments, des chevelures dénouées l’éventaient. L’air était lourd de musc et d’une odeur sucrée d’un ancien aromate : le sarcanthus » (page 81). On ne sait ce qu’il faut le plus admirer ici, du flou savant des premières notations et de l’inquiète précision du détail final. Dira-t-on que Nathalie Henneberg n’a pas su choisir entre la pureté visionnaire des surréalistes et la transfiguration par le style des classiques, entre la vérité et la beauté ? Nous pensons plutôt qu’elle témoigne d’une sensibilité suffisamment riche pour être affectée en même temps, et de façon également fine, par une forme, un parfum, une phrase. C’est la caractéristique des visionnaires complets. Si les notations s’accumulent, ce n’est pas pour le plaisir de planter un décor ou de placer une description. Même quand elles paraissent dépourvues de rapport direct avec la situation, elles représentent une fuite vers le monde extérieur : « Cela ne tirait pas à conséquence, c’était un plaidoyer pour un mort : Ruy Béarn. La première journée touchait à sa fin, Isis resplendissait, le premier anneau se frangeait d’or et de pourpre et l’on entrevoyait un second cercle parfait. Entre les deux défaillait une échappée de ciel, couleur de turquoise morte » (page 94). Le plus souvent, d’ailleurs, les échappées descriptives sont associées à une situation précise dont elles rehaussent la valeur. Deux groupes humains hostiles trouvent dans l’extériorité du paysage une confirmation de leur solitude : « Ils marchaient côte à côte sur la piste. Les deux groupes d’astronautes les suivaient sans se mêler. Un vent sec d’Isis les environnait de tourbillons de sable et le soleil Alpha rasait le bord de la plaine, rouge feu » (page 156). La montée de l’inquiétude est soulignée par un regard des gardes : « La conférence entre les terriens et les ambassadeurs de R’rhia se prolongea tard dans la nuit. Alix rentra seule dans la tour blanche et rouge. Les ombres des sentinelles étaient nettes sur les créneaux » (page 165). Mais les plus incontestables réussites sont celles où la description, par elle-même, exprime la tension dramatique de la situation. Tantôt c’est l’isolement de la tour, qui apparaît de plus en plus héroïque à mesure que l’agression se révèle plus dérisoire et plus insultante – apologie du sang-froid tout entière contenue dans un effet de style : « La tour solitaire défiait l’inconnu, elle était semblable à un phare, à une goélette, assaillie de vagues de granit et de phosphorescences, criblée de météorites et envahie de migrations de lézards » (page 77). Tantôt c’est la vision du camp par le héros sauvé de la mort et comme étranger à ces astronautes qu’il va bientôt trahir, mais qui n’en ressent que mieux, au niveau de la perception, la colère et la majesté de son univers : « Un couchant impérial inondait d’or et de sang le désert, le double anneau projetait ses phosphorescences et ses prestiges, et lorsque Ruy Léans émergea du souterrain, il vit le pylône géant – noir, sur les falaises en flammes » (page 72). Plus brève, cette image de l’univers mortuaire où il s’enfonce après sa trahison définitive : « Mais une barre bleue surgit à l’horizon et, sans transition, sur une étendue couleur de sang séché, surgit l’astre sans rayons » (page 96). Et pour finir, une évocation prise dans une situation de crise, pour montrer que les dons de l’auteur ne sont pas d’ordre exclusivement statique – il s’en faut : « La lueur indigo baignait la plaine, chaque tertre était une éponge saturée de radiations. En bas, les poulpes et les sauriens étaient agités de secousses galvaniques. Des masques phosphorescents collaient aux visages des terrestres et des androïdes » (page 187). La magnificence de son jardin secret Nathalie Henneberg l’éprouve plus encore que son lecteur, avec peut-être une secrète inquiétude, comme si cette beauté résolvait trop facilement nos angoisses pour n’être pas la beauté du diable, et l’effet d’une malédiction : « Obscurément, Arnold pensa que ce monde était trop parfait, trop pareil à ses rêves, comme si lui ou Alix l’avait choisi sciemment. Il sut que la vie lui donnait trop tout à coup et qu’il le paierait de son sang. Il soupira, comme celui qui, mourant de soif, arrive enfin en vue d’une source vive ; il se pencha sur les lèvres pâles et but » (Page 74). Nous boirons nous aussi, en espérant toutefois survivre à l’ambroisie hennebergienne, forts de notre perception grossièrement imparfaite et de notre tendance aux raisonnements ; mais non sans éprouver parfois, l’espace d’un éclair, l’attrait de son univers de vertiges déchaînés, auquel il ne tiendrait qu’à nous de nous laisser glisser, s’il n’était plus moral, encore que plus monotone, de nous maintenir à la surface. Le lecteur qui s’arrache aux sortilèges de la forme, cherchant à décrypter à travers ces symboles le message que Nathalie Henneberg a voulu lui transmettre, notera d’abord son attachement à des valeurs passées, voire périmées. Non que ce rêve en forme de roman ait la moindre affinité avec un manifeste politique. Mais si l’auteur, à l’instar de son héros, cherche à « briser le cadre étroit de la réalité », c’est que ce cadre lui est un enfer, pour des raisons qui lui sont propres. Quoi d’étonnant alors si son refuge, aussi secret, aussi personnel soit-il, reflète son choix ? Par un mouvement naturel, elle enchâsse dans sa rêverie, comme dans un très vieux temple ou dans un reliquaire précieux, ces valeurs qui lui sont précieuses, et qu’elle voit disparaître avec nostalgie. L’univers de Nathalie Henneberg est fondé sur une hiérarchie naturelle : il est question ici de « respect atavique » et de personnages qui ont besoin, pour se délivrer des formes, d’oublier leur « condition de subordonné ». La religion, l’honneur, le drapeau, la mission définissent les limites de leur horizon intellectuel et moral. Il n’est pas jusqu’à leur apparence (puisque nous sommes ici dans l’univers des correspondances) qui n’en fasse des stéréotypes aristocratiques à la manière de la collection Signe de Piste : leurs caractères les plus fréquemment marqués sont la grâce, l’élégance et la clarté qui les apparentent aux archanges et, sur le plan moral, la pureté, l’ardeur et la dureté ; leur destinée est d’être Prince et Messager. Le monde extérieur, ce monde qui est nôtre, est un cachot et sa médiocrité se manifeste par la peur des mutants, c’est-à-dire des êtres d’exception. La satire de l’humanité moyenne est pratiquement absente de ce roman, mais quand elle se manifeste, c’est avec une vigueur exceptionnelle : « As-tu vu, demanda Gil, dans l'antichambre, un petit troupeau gras, broutant les pâtisseries ? Ce sont mes épouses r’rhi que je viens de répudier. Mais elles reviennent » (page 176). L’aspect politique de la question n’est pas soulevé, au moins en apparence. Mais ces Violets, qui habitent de l’autre côté de l’hypersphère, font plus d’une fois penser à certains Rouges de notre connaissance. Et les indigènes R’rhia, soumis par les Violets, mais fort perméables en fin de compte au paternalisme des légionnaires de l’espace, évoquent d’autres problèmes bien connus sous un angle propre à Nathalie Henneberg. Le danger est que « ces grandes bêtes nues » n’ont pas derrière elles une civilisation qui les eût vêtues de solides traditions morales. Mais l’excès d’intelligence et de culture n’est pas moins nocif : « Non, nous sommes encore quelques-uns, des phénomènes ou des monstres, avec notre lucidité. Une force inconnue nous pousse vers l'abîme. Mais on peut encore remonter, on peut lutter et vaincre, n’est-ce pas ? – On peut tout, dit le blessé d'une voix sourde » (page 66). La véritable solution pour le civilisé est donc dans l’exaltation d’une sensibilité irrationnelle, dernière garantie de pureté en ce monde, mais cette formule a sa contrepartie elle aussi : car ces héros par trop sensibles, ces « rêveurs professionnels » sont promis en ce monde à une destinée de souffrance, et l’auteur s’étend longuement sur leur visage pathétique, halluciné ou torturé et sur leur sourire sans joie. À ces parias du monde moderne, la Légion de l’Espace offre un refuge. Ils y cultivent la simplicité, l’esprit d’équipe, la camaraderie, l’amitié – je n’ai rien contre cela – l’énergie et la persévérance – je suis toujours d’accord – mais aussi le sacrifice, et là, rien ne va plus. Qu’un groupe d’hommes, véritable « trou dans le néant », puisse être sacrifié par la Terre pour une renaissance qu’aucun d’eux ne verra, qu’ils puissent être oubliés dans un coin de l’espace au point que leurs chefs eux-mêmes ne comprennent plus le sens de leur mission, rien de plus normal – cela s’est déjà fait souvent, à quelques détails près. Mais qu’ils puissent trouver une consolation dans la pratique de la simple obéissance, et aussi dans la conviction, méprisante sinon hâtive, que ceux qu’ils protègent ne les valent point, c’est là une façon de penser que je ne saurais partager avec Nathalie Henneberg. Ce qui est sûr, c’est que ces hommes ont renoncé à vivre. Le temple est peuplé de fantômes, dont le plus pur est sans doute Arnold de Held, « libre spatial sans attaches », avant tout préoccupé de « tenir », et dont le sacrifice final est celui d’un homme déjà mort depuis longtemps : « Il fonçait vers l'infini, le néant, la mort dans les étoiles à bord d’un Hollandais volant. Un capitaine aux traits ailés, aux calmes yeux verts menait sa goélette parmi les maelstroms et les météores, vers un soleil qui ne s’éteint jamais. Une vague se leva, couronnée d’astres et de flammes…, et le ciel croula » (page 224). Il ne servirait à rien de polémiquer avec l’auteur d’un roman dont l’intention n’est pas polémique. Elle peut penser ainsi : c’est son droit. Nous nous contenterons donc d’avouer nos difficultés à nous adapter, car tout cela nous est fort étranger. Au demeurant, si « La forteresse perdue » n’avait que cette valeur d’affirmation, ce ne serait pas un bien grand livre. Son excellence vient d’ailleurs. L’étroitesse du cadre idéologique, surtout marquée dans la première moitié du livre, est transcendée en fin de compte parce que son auteur ne se contente pas de le subir comme une fatalité passivement acceptée, mais le vit comme un drame intérieur, aux prolongements métaphysiques. Cette fois-ci, on ne nous accusera pas d’extrapoler : le mot est prononcé (page 228). Le thème de l’ouvrage – les univers parallèles – est d’ailleurs, avec celui du voyage dans le temps, un des deux grands thèmes métaphysiques de la science-fiction, et Nathalie Henneberg en fait ici une exploration des plus complètes. Les univers parallèles, dans « La forteresse perdue », ne cessent de se mélanger, ce qui se traduit par une intrusion massive de contingence et d’incertitude dans l’enchaînement des effets et des causes. Promesse de liberté pour l’homme ? Peut-être, mais aussi bien promesse d’anéantissement, car cet univers instable et divers dans la tradition d’Héraclite rend les souvenirs inutiles et donne l’impression que tout n’est qu’illusion, ce qui conduit à une existence de solitude et de cauchemar. Même les univers séparés tirent de leur isolement une existence amoindrie et comme onirique : « La ville vivait dans son propre continuum, avec sa mer lourde comme des saphirs, son air vénéneux, ses troupeaux d’automates » (page 119). Les hommes qui vivent dans ce cauchemar montrent une aspiration nostalgique à la stabilité, symbolisée par le salut à l’étoile polaire, seul point fixe de l’univers. Dès le début, ce bouillonnement incohérent donne l’impression d’être une simple apparence, derrière laquelle des forces négatives sont à l’œuvre : « Les astronautes perçurent tous, simultanément, la notion d’une entité qui était autre chose. Ou qui n’était pas. Des barrières incroyablement précises préservaient l’univers de la désagrégation » (page 21). L’univers démoniaque qui se révèle peu à peu – celui des Violets – est exactement l’inverse de notre univers : il est immatériel mais stable, ce qui définit assez bien l’état de mort. C’est donc le néant qui cherche à s’emparer de notre monde, à travers la diversité des univers parallèles. Mais les forces du néant se bornent au pouvoir de créer des illusions et des caricatures de notre monde, maquettes ou androïdes qui ne peuvent gagner un combat réel : car la puissance du diable est limitée. Aussi convient-il d’établir un pont entre les deux univers, ce qui paraît difficile car ils n’ont aucun point commun et qu’il n’y a entre eux que des solutions de continuité : « L’édifice de jaspe était grandiose et vide comme tous les lieux où les cosmos s’effleurent » (page 102). Ce qu’il leur faut, c’est donc retrouver leur univers dans le nôtre. Ils pensent y parvenir avec Ruy Béarn, le personnage principal, et toute l’histoire est le récit de leur tentative. Ruy, qui n’a rien d’un héros, n’est pas du tout amateur de sacrifice, et sa mentalité est jugée au départ : quand il s’engage dans la Légion, c’est sous le nom d’un euphorique. Acculé par des pièges savants, il finit par trahir, ce qui nous vaut de nouveaux développements sur le thème de la contingence : car il a choisi librement, mais il est captif de son choix et incline à penser que ce monde n’est pas le sien, que dans un autre univers il est libre et heureux. Ici en tout cas, il est soumis à son enfer privé, et les Violets peuvent espérer la victoire, d’autant plus que la blonde Alix, qui seule pouvait comprendre Ruy, s’abîme en une passion semi-onanique pour un être exactement semblable à elle, au sexe près. Elle a aussi son enfer intérieur, aux couleurs édéniques celui-là, puisque c’est le souvenir du lieu tranquille où elle a passé son enfance avec cet homme, et où elle a préféré se réfugier, le jour où Ruy est parti pour l’espace découvrir une planète qui s’appelle Ariane. Dans d’autres univers, elle lui est destinée ; dans celui-ci, elle a fait un choix tout différent. Mais la contingence n’est pas seulement une porte ouverte au hasard, elle recèle aussi pour l’homme une possibilité de créer. Ruy et Alix sont précisément ces deux mutants qui peuvent bouleverser l’enchaînement des effets et des causes : « Elle était un de ces êtres qui pétrissaient et sculptaient les mondes, un de ces êtres auxquels appartiendrait l’avenir » (page 80). Si pendant tout le roman ils refusent de jouer ce rôle, c’est pour des mobiles purement personnels : lui, à cause de son enfer intérieur ; elle, par attachement pour sa passion enfantine. Et si à la fin Ruy devient réellement un créateur d’univers et réussit à faire exister ce monde pur de toute force d’anéantissement où Alix et lui auront le destin dont il rêvait, c’est également par une démarche tout intérieure : parce qu’il a renoncé. Cet acte gratuit auquel il aboutit est bien un peu suspect ; disons donc simplement que cet acte est gratuit en ce qu’il n’est pas égoïste, et qu’il y a là, effectivement, une solution possible au problème du hasard. Isis, reine du pays des morts, est aussi la déesse de la résurrection. Cette conclusion, pourquoi ne pas l’avouer, nous plaît beaucoup, et aussi que le héros de l’histoire y soit parvenu par l’effet d’une simple décision. Car notre meilleur triomphe sur la mort, c’est encore de vivre, et non de nous complaire dans le souvenir d’un passé enfui. La forteresse perdue alors n’a plus besoin de murs : l’homme n’est plus en enfer sur Terre, dès lors qu’il est venu à bout de son enfer personnel. Jacques GOIMARD |
| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112198 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |