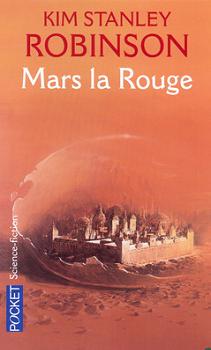|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Mars la rouge
Kim Stanley ROBINSON Titre original : Red Mars, 1993 Première parution : New York, USA : HaperCollins, septembre 1992 ISFDB Cycle : La Trilogie martienne  vol. 1 vol. 1  Traduction de Michel DEMUTH Traduction révisée par Dominique HAAS Illustration de Wojtek SIUDMAK POCKET (Paris, France), coll. Science-Fiction / Fantasy  n° 5831 n° 5831  Dépôt légal : octobre 2007 Réédition Roman, 672 pages, catégorie / prix : 11 ISBN : 978-2-266-13834-5 ✅ Genre : Science-Fiction
Autres éditions
FRANCE LOISIRS, 1999 LIBRE EXPRESSION, 1997 in La Trilogie martienne, OMNIBUS, 2006 in La Trilogie martienne, 2012 POCKET, 2003, 2003, 2011, 2023 PRESSES DE LA CITÉ, 1994, 1997, 1998, 2001, 2018
Quatrième de couverture
Mars la Rouge, ce n'est pas pour demain, c'est déjà aujourd'hui ! Ils sont arrivés. Leur but ? Recommencer l'Histoire dans un décor nouveau. Bâtir un monde neuf, en rupture avec la Terre déliquescente qu'ils ont quittée. Sous le leadership de deux Américains, John Boone et Frank Chalmers, et d'une Russe, Maya Toitovna, les colons s'attaquent à l'installation des infrastructures de base sur la planète. Il faut descendre dans ses canyons vertigineux pour y chercher de la glace, ensemencer les vallées où coulèrent les fleuves, il y a des millions d'années. Il faut inventer de nouvelles villes, avec des matériaux et des concepts nouveaux. Des cités de rêve, greffées sur le désert, au flanc des plus grands volcans du système solaire. Et il faut faire vite, car les immigrants arrivent, de plus en plus nombreux, en provenance d'une Terre surpeuplée. Le rêve sombrera-t-il dans le chaos ? C'est que Mars, si éloignée du berceau de l'humanité, constitue un incroyable enjeu économique et politique pour les puissances terrestres : les transnationales, sociétés tentaculaires dotées d'un tel pouvoir qu'elles peuvent racheter des pays, des États... des mondes, peut-être. Critiques des autres éditions ou de la série
Mars, un nouveau rêve américain Sous la plume de Kim Stanley Robinson, la conquête de la planète rouge tient de l'épopée et de la fresque sociale. D'un réalisme saisissant. Dans cent ans, Mars la Rouge sera un manuel d'histoire. Tout y paraît si net, si étayé, si concret que le lecteur doit se répéter à chaque page que ce livre n'est aujourd'hui qu'un roman de science-fiction. Mais quel roman : l'on chercherait en vain la moindre faille dans cette construction d'orfèvre, oeuvre du plus fin et du plus réaliste des anticipateurs américains. Mars la Rouge est le premier volet d'une saga qui commence au début du siècle prochain. Cent astronautes sont envoyés sur Mars avec la mission d'y bâtir une colonie autonome, après neuf mois de navigation interplanétaire. Ces aventuriers d'élite concentrent les connaissances et le savoir-faire de leur monde d'origine. Mais celui-ci, surpeuplé et exangue, a aussi placé en eux les plus folles espérances. Cet héritage pèse lourd sur les consciences des explorateurs, rejoints quelques années plus tard par de nouveaux contingents d'immigrants. Très vite, la raison scientifique cède le pas aux conflits d'intérêts, de nations et d'idéologies. Pour les uns, Mars est un champ libre où tenter les expériences les plus audacieuses. Pour les autres, une planète vierge à préserver des dépradations humaines. Certains voudraient dèjà s'affranchir de la tutelle terrienne, d'autres ne songent qu'à vendre des concessions minières aux multinationales de l'espace. A ces dissensions, s'ajoutent les affrontements de personnes, les déchirements de coeur et les jalousies mesquines ; toutes choses dont hommes et femmes, si savants soient-ils, n'ont su alléger leurs bagages en quittant le sol natal. L'art narratif de Kim Stanley Robinson ne s'exerce pas qu'à filmer une société avec les yeux de plusieurs protagonistes. Il instruit son public d'une foule de renseignements astronomiques ; il l'éblouit par de vertigineuses descriptions de paysages ; il lui montre les miracles technologiques qu'accompliront les ingénieurs de demain. La visite des canyons martiens, profonds de trois kilomètres, le survol des volcans géants de Tharsis (les plus hautes montagnes du système solaire) ou l'arrimage du prodigieux ascenseur de l'espace reliant la planète à l'un de ses satellites valent à eux seuls le voyage. Mais débarquer sur Mars est surtout pour Robinson l'occasion de réécrire l'histoire américaine en s'inventant un nouveau Nouveau Monde. On sent chez lui une fascination des origines, du temps héroïques des pionniers, des commencements douloureux où les peuples en crise tirent les cartes maîtresses de leur destin. Le récit se ressent de cette tension : chaque personnage compte, comme si le moindre de ses gestes ou de ses mouvements d'humeur devait faire basculer le futur. Comme si l'homme, livré à lui-même, devenait l'artisan d'une nouvelle genèse. François ROUILLER (site web) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes
François Rouiller : 100 mots pour voyager en science-fiction (liste parue en 2006) pour la série : La Trilogie martienne |
| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |