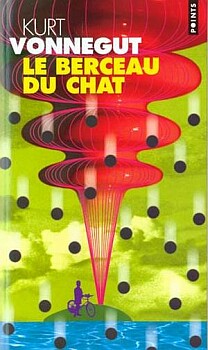|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Le Berceau du chat
Kurt VONNEGUT Jr Titre original : Cat's Cradle, 1963 Première parution : New York, USA : Holt, Rinehart and Winston, avril 1963 ISFDB Traduction de Jacques B. HESS Illustration de Marion BATAILLE SEUIL (Paris, France), coll. Points  n° P833 n° P833  Dépôt légal : février 2001 Roman, 320 pages, catégorie / prix : 8 ISBN : 2-02-048501-X ❌ Genre : Science-Fiction
Quatrième de couverture
En 1963, le journaliste Jonas entreprend d'écrire un livre sur Hiroshima et la bombe atomique. Ses recherches l'amène à s'intéresser à l'un des pères de la bombe, le Dr Hoeniker, par ailleurs inventeur d'un produit appelé « Galce-9 » qui fait geler l'eau. En retrouvant le fils d'Hoeniker sur une île des Caraïbes, Jonas va passer un séjour étonnant dans une république bananière. L'île est aux mains d'un dictateur, secondé par un déserteur et une sorte de gourou, Bokonon, qui a inventé la religion bokononiste et qui prèche une apocalypse imminente... Véritable réquisitoire contre la bêtise humaine, ce roman picaresque et comique, dans la lignée de la « science-fiction pop » chère à Kurt Vonnegut, met en lumière toute l'absurdité d'un monde aux valeurs contrefaites. Critiques des autres éditions ou de la série
Abattoir 5, sorti voici un an (et critiqué dans notre numéro 214), datait de 1969. Le berceau du chat, que les Editions du Seuil éditent aujourd'hui, possède un copyright de 1963, et il n'est pas défendu de penser que c'est le succès remporté par le précédent roman de Kurt Vonnegut qui a poussé son éditeur à aller chercher plus avant dans son œuvre. Quoi qu'il en soit, la parenté entre les deux romans est flagrante : Vonnegut travaille dans la continuité. Et s'il est patent que l'auteur des Sirènes de Titan a quitté la SF, il n'en demeure pas moins vrai que celle-ci continue à lui servir de tremplin. Le berceau du chat, plus encore que Abattoir 5, se sert de la SF pour faire un pied de nez à la réalité, pour prendre du recul par rapport à elle, pour la faire glisser dans le seul tiroir qui soit vraiment à sa taille : celui de l'absurde. Comme Abattoir 5, Le berceau du chat est centré sur une destruction massive, et le reflet de cette destruction en littérature. Mais, alors que dans le premier roman cité il s'agissait du bombardement de Dresde et du livre que le narrateur voulait écrire au sujet de cette tragédie, Vonnegut a choisi pour le second (rappelons qu'il ne s'agit que de l'ordre de parution en France) l'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima. Dresde, Hiroshima, une même horreur, une même logique absurde de la guerre : l'assassinat de 100 000 civils ou plus. Hier Billy Pèlerin, aujourd'hui Jonas, enquêtent donc sur ces journées qui n'ont guère ébranlé le cours d'une guerre finissante de toute façon, mais dont l'évocation fait toujours frémir. A la différence de Billy, toutefois, Jonas n'a pas été témoin du cataclysme (comment l'aurait-il pu ?), aussi ne cherche-t-il pas à écrire sur l'explosion elle-même, mais sur les faits et gestes des gens qui ont été dans l'entourage du « père » de la bombe, Félix Hoenikker, décédé depuis, mais dont les trois enfants sont encore en vie. Et comme Billy, cependant, Jonas n'écrit pas le livre qui est à la base de sa quête. Il en écrit un autre, le livre de cette quête (ou enquête), le livre que le lecteur peut tenir entre ses mains sous le titre de Le berceau du chat. Mais c'est un livre aussi inutile que celui qui aurait dû primitivement être écrit, et aussi inutile que n'importe quel autre livre possible en face d'une tragédie comme celle d'Hiroshima, et de tous les autres Hiroshima potentiels contenus dans l'invention de la bombe atomique. Car, lorsque Jonas l'achève, il est à peu de chose près le dernier homme vivant sur Terre, et le livre ne peut avoir d'autre lecteur que son propre auteur. La boucle est bouclée : « Si j'étais plus jeune, j'écrirais une histoire de la bêtise humaine ; et je monterais jusqu'au sommet du mont McCabe, où je m'allongerais sur le dos avec mon histoire en guise d'oreiller ; et je prendrais par terre un peu du poison bleuâtre qui transforme les hommes en statues ; et je me transformerais en un gisant au sourire sardonique, un pied de nez dressé vers Qui-vous-savez. » (p. 203 et dernière). Pour que cette boucle se boucle, il aura fallu cependant le temps d'un livre, le temps qui s'écoule entre Hiroshima et la fin du monde pressentie. Un livre absurde, naturellement, qui raconte n'importe quoi, n'importe comment : précisément Le berceau du chat, où l'on ne trouve pas plus de berceau ou de chat que de tambour ou de trompette selon Bernard Shaw, simplement une figure abstraite faite avec de la ficelle tendue entre des doigts croisés et qui se nomme « berceau du chat ». Comment Jonas contacte les enfants Hoenikker, Newton le nain qui faillit épouser une danseuse ukrainienne aussi petite que lui et ayant « choisi la liberté », Angela, fanatique de la trompette et Frank, passionné de modèles réduits, devenu général dans la République de San Lorenzo, île des Caraïbes plus ou moins calquée sur Haïti ; comment Jonas s'embarque à destination de San Lorenzo où il est appelé à succéder au vieux dictateur « papa » Mozano ; comment il en vient à épouser la foi en Bokonon, prophète san lorenzien qui s'exprime en « calypsos » d'une grande sagesse ou d'une grande stupidité, et dont le livre sacré commence par : « Toutes tes vérités que je vais vous dire sont des mensonges éhontés » ; et comment cette histoire absurde suscitée par un monde qui ne l'est pas moins prend fin, et comment le monde prend fin lui aussi peu avant la fin de l'histoire... c'est ce que vous apprendra Le berceau du chat, un livre d'à peine deux cents pages, divisé en 127 tout petits chapitres, parce qu'il faut bien faciliter la lecture aux généraux que Vonnegut, dit-on, souhaite avoir parmi ses lecteurs. Mais un général s'égarerait sûrement à la lecture du Berceau du chat, en cherchant et le berceau, et le chat. Et si par hasard ce général arrivait jusqu'à la page 180, il s'étoufferait sûrement en lisant ce curieux discours prononcé lors d'une cérémonie en l'honneur des « Cent martyrs de la démocratie » : « Je ne dis pas qu'à la guerre, s'ils doivent mourir, les enfants ne meurent pas comme des hommes. A leur honneur éternel comme à notre éternelle honte, c'est bien comme des hommes qu'ils meurent, rendant ainsi possible la célébration virile des fêtes patriotiques. Ils n'en sont pas moins des enfants assassinés. Et je vous propose ceci : si nous devons rendre sincèrement hommage aux cent enfants perdus de San Lorenzo, nous ne saurions mieux passer la journée qu'en méprisant ce qui les a tués, c'est-à-dire la bêtise et la méchanceté de toute l'humanité. Quand nous commémorons les guerres, nous devrions peut-être arracher nos vêtements, nous peindre en bleu et marcher à quatre pattes toute la journée en grognant comme des porcs. Ce serait surement plus approprié que les grands discours et les étalages de drapeaux et de canons bien huilés ». C'est presque du Cavanna : Kurt Vonnegut n'y va pas de main morte. Sa république d'image d'Epinal, ses savants fous et distraits, sa religion fantoche ont certes de quoi irriter. Mais cet usage immodéré d'archétypes qui ont fait leur temps et font eau de toutes parts répond à un but bien précis : enfoncer le clou de l'absurde dans le crâne des lecteurs, qu'ils soient ou non généraux. Et même ce portrait express de l'écrivain (« Ecoutez : quand j'étais plus jeune — il y a de cela deux épouses, 250 000 cigarettes, 3 000 litres de tord-boyaux »), qui ne fera pas sourire du bout des lèvres et semble issu d'une Série Noire des années 40 — gageons que c'est tout à fait voulu, que la lourde patte de Vonnegut s'est faite plus pesante encore, pour bien être à la hauteur de ses cons de généraux de lecteurs, pour bien nous faire comprendre que la littérature, après tout... Que dire alors de cette fin du monde qui tire un trait sur tout ? Provoquée par la « glace-9 », une substance inventée juste avant sa mort par Hoenikker (sur la demande d'un général — bien sûr ! — qui avait la hantise de la boue et des marines qui s'enfoncent dedans en montant à l'assaut), substance qui a la particularité réjouissante de transformer, par réaction en chaîne, toute l'eau du globe (y compris celle contenue dans le corps humain) en glace, elle est naturellement le contraire de l'apocalypse nucléaire : ici les flammes de l'enfer, là le blanc et silencieux gel — la mort « propre » dont rêvent les stratèges de l'absurde, l'arme absolue et absolument efficace, les cristaux qui lavent plus blanc, que Barjavel déjà, dans Le diable l'emporte, avait utilisée avec le même humour vengeur sous le terme de « eau drue ». Avec la glace-9 apparaît donc la SF, qui en a vu d'autres mais tient, ici comme ailleurs, un rôle essentiel celui d'extrapoler sur la réalité, de façon à ce que cette réalité, secouée dans sa matière atomique, nous explose en pleine figure et nous montre à nu son cadavre, avec ses poumons cancéreux et ses tripes rongées par les vers. Doit-on ajouter (même si Le berceau du chat ne nous parait pas tout à fait au même niveau de réussite que Abattoir 5) que Kurt Vonnegut Jr est un grand écrivain ? C'est inutile. Mais que cette grandeur soit faite d'archétypes remoulus, d'un gros humour qui met les pieds dans le plat, d'une « hénaurmité » de situations qui va au-delà de la contestation proprement politique — cela ne semblera-t-il pas surprenant ? Pas davantage, car ces traits forment le portrait d'une Amérique qui a trouvé, en Vonnegut, un écrivain à sa mesure. Certes, il n'est pas le seul. Mais c'est justement ce qu'il y a de merveilleux. Jean-Patrick EBSTEIN Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes
Annick Béguin : Les 100 principaux titres de la science-fiction (liste parue en 1981) Jean-Bernard Oms : Top 100 Carnage Mondain (liste parue en 1989) Lorris Murail : Les Maîtres de la science-fiction (liste parue en 1993) Association Infini : Infini (2 - liste secondaire) (liste parue en 1998) Francis Berthelot : Bibliothèque de l'Entre-Mondes (liste parue en 2005) |
| Dans la nooSFere : 87464 livres, 112452 photos de couvertures, 83902 quatrièmes. |
| 10893 critiques, 47247 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |