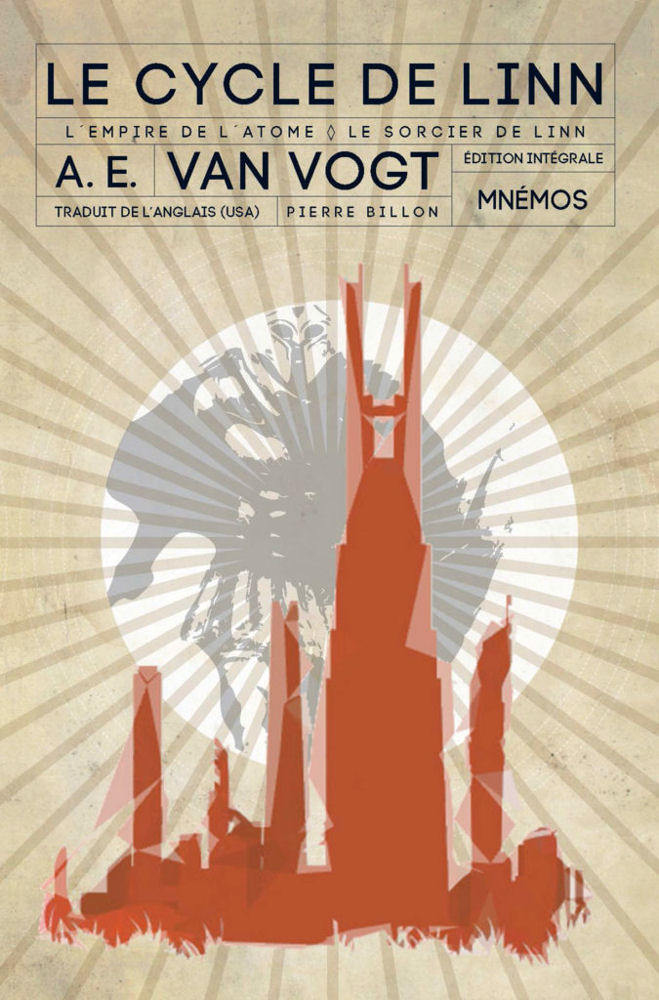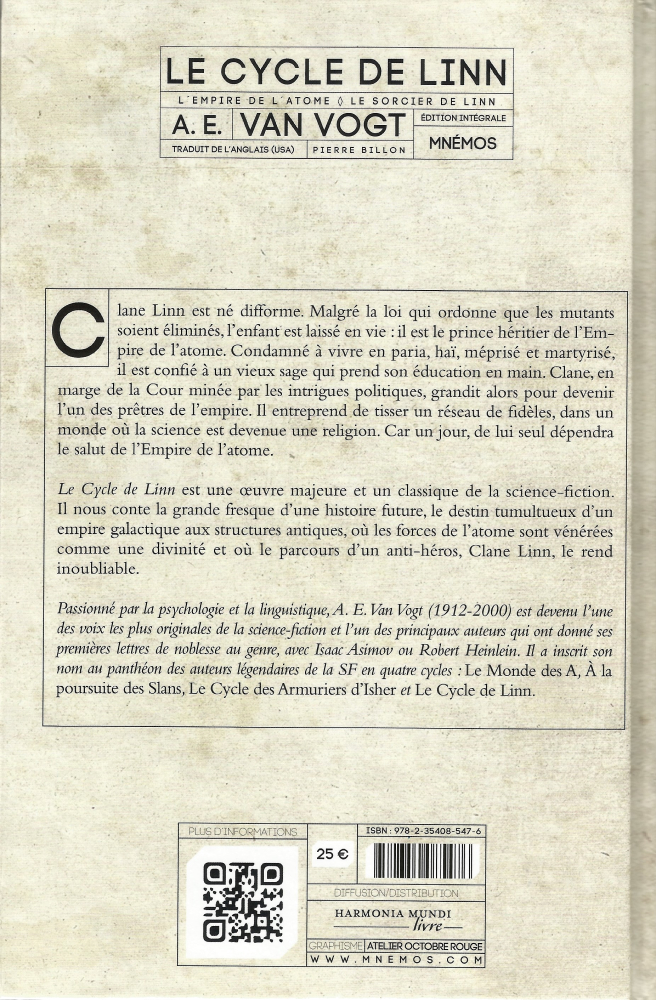|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
Le Cycle de Linn
Alfred Elton VAN VOGT Cycle : Le Cycle de Linn (omnibus) Traduction de Pierre BILLON MNÉMOS (Saint-Laurent d'Oingt, France), coll. Intégrales   Dépôt légal : avril 2017, Achevé d'imprimer : mars 2017 Réédition Recueil de romans, 402 pages, catégorie / prix : 25 € ISBN : 978-2-35408-547-6 Format : 16,0 x 24,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Couverture : Atelier Octobre Rouge.
Quatrième de couverture
Clane Linn est né difforme. Malgré la loi qui ordonne que les mutants soient éliminés, l’enfant est laissé en vie : il est le prince héritier de l’empire de l’Atome. Condamné à vivre en paria, haï, méprisé et martyrisé, il est confié à un vieux sage qui prend son éducation en main. Clane, en marge de la Cour minée par les intrigues politiques, grandit alors pour devenir l’un des prêtres de l’empire de l’atome. Il entreprend de tisser un réseau de fidèles, dans un monde où la science est devenue une religion. Car un jour, de lui seul dépendra le salut de l’Empire de l’Atome.
Le Cycle de Linn est une œuvre majeure et un classique de la science-fiction. Il nous conte la grande fresque d'une histoire future, le destin tumultueux d'un emprire galactique aux structures antiques, où les forces de l'atome sont vénérées comme une divinité et où le parcours d'un anti-héros, Clane Linn, le rend inoubliable. Passionné par psychologie et la linguistique, A. E. Van Vogt (1912-2000) est devenu l’une des voix les plus originales de la science-fiction et l'un des principaux auteurs qui ont donné ses premières lettres de noblesse au genre, avec Isaac Asimov ou Robert Heinlein. Il inscrit son nom au panthéon des auteurs légendaires de la SF avec quatre cycles : Le Monde des A, À la poursuite des Slans, Le Cycle des Armureries d’Isher et Le Cycle de Linn.
Sommaire
Afficher les différentes éditions des textes1 - L'Empire de l'atome (Empire of the Atom, 1957), pages 5 à 196, roman, trad. Pierre BILLON 2 - Le Sorcier de Linn (The Wizard of Linn, 1962), pages 197 à 394, roman, trad. Pierre BILLON
Critiques
Le cycle de « Linn » est considéré comme une des œuvres importantes de van Vogt, même s’il n’atteint pas tout à fait l’aura de ses livres ou cycles les plus fameux. Le premier tome, L’Empire de l’atome, est ainsi formé de cinq nouvelles publiées de mai 1946 à décembre 1947 dansAstounding, tandis que le second, Le Sorcier de Linn, est paru dans la même revue sous forme d’épisodes entre avril et juin 1950. L’œuvre de van Vogt comprend de très nombreux autres fix-ups, mais la différence avec, par exemple, La Guerre contre le Rull ou Quête sans fin, est qu’ici, les « coutures » se voient très peu, et que l’ensemble donne une impression de cohérence qu’on ne retrouve pas dans les ouvrages précités. Avant d’analyser le contenu de ces deux romans, on ne peut qu’être frappé par les similitudes avec le cycle de « Fondation » d’Isaac Asimov, dont les premiers romans sont également des fix-ups composés de nouvelles publiées dans Astounding dans les années quarante : dans les deux cas, l’empire romain sert de source d’inspiration (sa chute chez Asimov, sa structure et ses dirigeants pour van Vogt : on remarquera que ce cycle est à la fois Asimovien et anti-Asimovien, puisqu’ici, la pseudo-Rome n’est pas associée à la fin de la civilisation, mais à sa renaissance), la science se pare des atours de la religion, et un mutant, ainsi que les pouvoirs psychiques, ont un rôle important à jouer dans l’intrigue. Des critiques comme James Blish et Damon Knight ont aussi relevé que cette dernière, ainsi que les personnages, présentaient de nettes ressemblances avec ceux de Moi, Claude, les mémoires imaginaires de l’empereur romain du même nom, publiées en anglais en 1934 par Robert Graves. Ainsi, chaque personnage de Graves possède sa contrepartie chez van Vogt : Medron Linn est l’empereur Auguste, Lydia est Livie, et le protagoniste, Clane, correspond à Claude. On trouve également de très nets équivalents de Tibère, de Caligula, etc., et les événements comme le comportement des personnages sont conformes au récit de Graves, lui-même en partie issu de l’Histoire bien réelle et en partie romancé. Dans L’Empire de l’atome, nous découvrons une Terre de l’an 12 000, huit millénaires après une guerre nucléaire. Certaines zones restent mortellement radioactives, mais contiennent de précieuses reliques technologiques des Anciens et autres indices sur ce qu’était l’ancien monde. La société, de très nette structure romaine, est dominée par la dynastie Linn, dont le dernier chef, Medron, a amené une explosion démographique sans précédent, puisque la population a doublé en un demi-siècle, atteignant désormais le chiffre colossal de 60 millions d’habitants… pour toute la planète. Ce qui reste de science et de technologie se pare des atours de la religion, celle des quatre dieux de l’atome, Plutonium, Uranium, Radium et Icks. On remarquera, au passage, que le pouvoir politique jugé démesuré du clergé, issu de son emprise sur des fidèles hautement influençables, exerce une forte pression sur l’État en plein (re)développement, contrecarrée via la guerre de conquête (sur Mars et Vénus) visant à unifier le Système solaire, conflit qui soustrait à l’influence du Temple des centaines de milliers de soldats en leur donnant une autre philosophie. Le dernier-né de la dynastie, et petit-fils de l’Empereur, nommé Clane, est un « enfant des dieux », un mutant physiquement déformé à cause des radiations émanant d’un des temples. Parce qu’il est de sang royal, et parce qu’il est pris sous son aile par de hauts dignitaires religieux et autres lettrés, il va non seulement se voir en grande partie épargné par l’ostracisme et les bastonnades qui forment le quotidien des mutants (quand on les laisse survivre…), mais bien plus que cela, il sera le seul d’entre eux à recevoir une éducation scientifique et politique. Et le jeune Clane va se révéler prodigieusement doué dans ces deux domaines, refusant d’exercer le pouvoir en pleine lumière, même quand il lui tend les bras, mais préférant, en coulisses (et malgré l’hostilité pouvant prendre un tour meurtrier de la part de certains membres de sa propre famille et de divers ennemis politiques), protéger l’empire, puis la race humaine, contre tout péril, qu’il soit interne ou, dans la fin du premier roman ou tout le second, venu des confins barbares du Système solaire ou de bien plus loin encore. À ce titre, Le Sorcier de Linn développe une longue odyssée interstellaire qui élargit beaucoup le cadre de l’action. Toutefois, pour Clane, le plus grand péril, c’est la tendance aux petites manigances des membres de la dynastie dont il fait partie, toujours occupés à intriguer alors que, littéralement, le palais brûle. Il a l’intrigue en horreur, même s’il la pratique pourtant volontiers quand cela sert ses intérêts. Et il devra défendre l’empire à la fois contre ses propres dirigeants, leur rapacité, voire leur folie, mais aussi contre les autres périls qui le menacent, qu’ils soient internes (révolte d’esclaves, influence trop grande de la religion, des intérêts financiers et bancaires, etc.) ou externes (peuples rebelles de Mars ou de Vénus, puis invasion de barbares venus du satellite Europe, voire de beaucoup plus loin). La fin de L’Empire de l’atome ménage un beau coup de théâtre et éclaire d’un jour nouveau les origines de la guerre nucléaire qui a anéanti notre civilisation pour donner celle de Linn : le diptyque est certes post-apocalyptique, mais pas de la manière dont le lecteur se l’était imaginé jusque-là. Le cycle est intéressant, le protagoniste fascinant, sa façon de régler toutes les crises traversées malgré l’opposition de tous passionnante, et l’amateur d’Histoire s’amusera à établir les correspondances qui s’imposent entre les personnages de van Vogt et leurs contreparties réelles ou fictionnelles chez Graves. Même si le propos a vieilli – les connaissances en matière de planétologie disponibles dans les années quarante étant maigres ou ayant été invalidées depuis –, la qualité de la traduction fait que le lecteur moderne, surtout s’il est sensible à la prose asimovienne, voire moorcockienne (période « Hawkmoon »), peut tout à fait prendre un sincère plaisir à la lecture de l’ensemble. À une condition préalable et indispensable, cependant : en effet, suite à certaines limitations technologiques ou interdits religieux (dont la cohérence est d’ailleurs lourdement mise en cause par la révélation de la fin de L’Empire de l’atome), les soldats et vaisseaux de l’empire ne disposent pas d’armes à distance autres… que des arcs. Ce qui conduit de fait à une ambiance très étrange, dans laquelle des pseudos-Romains du lointain futur débarquent sur Mars ou Vénus glaive ou lance à la main en faisant sortir des chevaux d’astronefs interplanétaires, qui, eux-mêmes, quand ils s’affrontent, le font en s’éperonnant, tels des galères antiques, ou s’attaquent aux troupes au sol à coups de flèches tirées par des archers embarqués ! Dire qu’il faudra une certaine suspension d’incrédulité, et / ou une affinité avec la science fantasy, pour passer outre pareille étrangeté est un minimum. Signalons que dans Le Sorcier de Linn, les choses deviennent plus orthodoxes, plus conformes à ce que l’on attend de la science-fiction, même si c’est, cette fois, l’inclusion de pouvoirs psychiques qui pourra poser problème à certains types de lecteurs. Et ce n’est qu’un des nombreux paradoxes du diptyque : Clane méprise la ruse, l’intrigue, mais y recourt pourtant si besoin ; il rejette la théorie de l’homme providentiel, pourtant tout dans le récit le désigne comme tel. Et ce ne sont là que deux exemples des contradictions d’un héros (d’un auteur ?) pétri de paradoxes. Tout compte fait, et même si le cycle de « Linn » ne bénéficie pas de l’aura de certains autres romans plus connus de van Vogt, il se révèle pourtant plus agréable à lire que nombre d’entre eux – ce qui explique sans doute sa récente réédition, contrairement à ces derniers. L’histoire de cet être que tout condamnait à l’anonymat, qui exerce, par un sens aigu de la frugalitas, un des sept fondements du mos majorum — les coutumes des ancêtes — si cher aux romains, le pouvoir en coulisses sans le revendiquer officiellement (alors qu’il lui suffirait de tendre la main pour s’en saisir tel un fruit mûr), et qui est le dernier politicien décent dans une ère d’intrigues machiavéliques sordides, est en effet tout à fait digne de lecture, voire d’éloges. Et de conclure que si Clane ressemble à Claude, il tient finalement tout de Cincinnatus. APOPHIS (site web) Van Vogt est l’un des maîtres incontestés de la SF américaine classique, connu en France pour ce Monde du non-A que traduisit Boris Vian, comme Baudelaire Poe en son temps. « Le cycle de Linn » (L’Empire de l’atome et sa suite, Le Sorcier de Linn) est moins notoire. À juste titre à mon humble avis. Fix-up rassemblant cinq histoires publiées dans Astounding, le premier roman se passe en 12 000 environ, sur Terre. Relevée d’une apocalypse nucléaire passée qu’on devine, l’humanité a fondé une société impériale qui vénère les dieux de l’atome (uranium, etc.). Politiquement, c’est un empire calqué sur la Rome d’avant les empereurs fous. Patriciens, chevaliers, plébéiens, esclaves, intrigues de cour, assassinats politiques, rebelles aux marches (Mars et Vénus), armée organisée en légions commandées par des généraux plénipotentiaires – c’est transparent au point d’en être gênant. A fortiori quand on réalise que, techniquement, cette race spatiopérégrine ignore l’électricité, communique par pigeons, combat avec épées, lances et flèches, après être descendue de vaisseaux spatiaux qui ne sont que de grosses barges de débarquement. La transcription que fait Van Vogt du « Moi, Claude, Empereur », de Robert Graves (de l’assassinat de César à celui de Caligula), sautera aux yeux de qui connaît un peu l’histoire romaine, même s’il n’a jamais ouvert le Graves. Le cycle raconte les luttes pour le pouvoir à la cour impériale de Linn, sur Terre d’abord, puis dans l’espace (Le Sorcier de Linn ), quand l’empire doit survivre à une brutale invasion étrangère. Son héros est Clane, petit-fils de l’empereur régnant et, hélas pour lui, mutant difforme. Protégé par un savant débonnaire du sort funeste réservé aux mutants, Clane devient un jeune puis un adulte d’une intelligence stupéfiante qui conseille les princes, dirige des armées, redécouvre la science ancienne, et se fait nombre d’ennemis rêvant de l’éliminer. Il trouvera son meilleur allié en la personne d’un général barbare vaincu et finira par diriger l’empire après l’avoir sauvé. Honnête et honorable, Clane, s’il se méfie des mouvements de la foule autant que Tarde et Le Bon réunis, et doit parfois sacrifier à contrecœur aux intrigues politiques, veut néanmoins abolir l’esclavage et changer la forme autocratique du régime. Lors de la guerre contre les Riss (« Russes »), il cherche à éviter l’extermination mutuelle en prônant une coexistence pacifique garantie par une forme locale de dissuasion. Empire romain mâtiné de Guerre froide et de course aux armements. Ces deux romans expriment donc l’inquiétude atomique de l’époque plus quelques valeurs et idées politiques. Hélas, elles sont bien mal servies par un texte discutable : invraisemblances scientifiques et techniques, développements sociopolitiques basiques, personnages fantomatiques mis à part les deux ou trois principaux, motivations des acteurs pas toujours compréhensibles, comportements parfois petit-bourgeois, et ne parlons pas de la bulle contenant l’univers en réduction ou des paysans téléporteurs, entre autres. On n’excusera que l’approche machiste, caractéristique de l’époque plutôt que de l’auteur. Et puis il y a cette écriture, scolaire, où distance, effectifs, termes des alternatives ou motivation des choix sont listés et décrits comme par un élève consciencieux. Rapide à lire mais impossible à prendre au sérieux. Sans même parler des troublants points communs entre Clane et le Mulet d’Asimov dans « Fondation », d’autant que les dates coïncident… Éric JENTILE Critiques des autres éditions ou de la série
Ce volume du C.L.A. porte à quinze le nombre de romans de van Vogt traduits en français ; six éditeurs différents se sont disputé ses livres, ce qui exclut toute politique coordonnée : le chiffre record des ouvrages traduits est donc dû avant tout à la faveur du public français, qui n’a cessé depuis quinze ans de considérer van Vogt comme le numéro un de la science-fiction. Désormais il n’y a plus que cinq de ses romans à traduire, dont au moins deux sont dignes d’attirer l’attention des éditeurs français : The mixed men et The beast (les autres étant Earth’s last fortress, une novelette, et enfin Planets for sale et The winged man, romans écrits récemment en collaboration avec Edna Mayne Hull – femme de van Vogt – et que je n’ai pas lus). Autre point à considérer : L’empire de l’atome et Le sorcier de Linn (qui forment un cycle) sont une des œuvres majeures de van Vogt, et à ce titre il faut bien dire que leur publication arrive à point nommé. Deux lettres récemment publiées dans le courrier des lecteurs (celle de Jacques van Herp et celle de M. François Benveniste) ont fait ressortir l’existence d’un problème de générations chez les amateurs de science-fiction. Des romans comme La faune de l’espace, À la poursuite des Slans, La guerre contre le Rull, Le livre de Ptath, Créateur d’univers – autant dire beaucoup des grands van Vogt – sont épuisés depuis longtemps ; pour les lire, il faut maintenant procéder à un quadrillage persévérant des bouquinistes et consentir à payer jusqu’à 20 ou 25 F (pour le Rayon Fantastique) des volumes brochés et parfois délabrés. Le C.L.A. a bien ressorti le cycle du non-A et celui des Armuriers, mais en édition de luxe à 30 F (il est vrai que pour ce prix on a deux romans). Dans les deux cas, les acheteurs se recrutent forcément parmi des gens convaincus d’avance de la qualité de ce qu’ils vont acheter. Les seuls romans de van Vogt actuellement disponibles à un prix modique sont Pour une autre Terre (Marabout) et La maison éternelle (Galaxie-Bis) qui, j’en ai peur, ne sont pas en mesure de convaincre un esprit non prévenu que leur auteur est le numéro un de la science-fiction ; le pourraient-ils qu’ils ne sont que deux, alors qu’il y a cinq ans encore on en trouvait jusqu’à dix en circulation en même temps. À ce compte, nous sommes en train de manquer la relève, l’indispensable relève sans laquelle rédacteurs et lecteurs de Fiction deviendront collectivement des petits vieillards bien propres, tout juste bons à saluer l’an 2000 d’un banquet où pulluleront les discours sur le thème : Ah ! quand reviendra le Rayon Fantastique ? Si nous voulons éviter de vivre cet instant peu soutenable, il faut nous débrouiller pour que se multiplient les traductions d’œuvres de grande classe : voilà pourquoi la sortie en français de L’empire de l’atome et du Sorcier de Linn est un événement réconfortant, auquel il faut souhaiter de nombreux petits frères. L’empire de l’atome réunit et adapte cinq nouvelles publiées en 1946 et 1947. C’est la période la plus agitée de la vie de van Vogt, celle où il multiplie les réflexions et les expériences pour résoudre les graves problèmes où il se débat : il vient de publier Le monde du non-A (1945), fruit de sa conversion à la logique de Korzybski, et prépare L’assaut de l’invisible (1946), bilan de sa tentative de guérir sa myopie par la méthode Bates. C’est aussi le temps de sa plus grande réputation aux États-Unis : le référendum conduit par Gerry de la Ree en 1947 le classe comme premier écrivain de science-fiction aux yeux des fans. C’est donc à un moment-clé de sa carrière, à tous points de vue, qu’il a conçu et réalisé L’empire de l’atome. La suite, Le sorcier de Linn, devait paraître directement sous forme de roman en 1950. Les deux livres soulèvent des problèmes d’apparence beaucoup moins métaphysique que Le monde du non-A et L’assaut de l’invisible, et van Vogt y paraît uniquement préoccupé de raconter une histoire. C’est bien ainsi que l’ont entendu les lecteurs américains, et le cycle de l’atome reste encore aujourd’hui pour eux l’œuvre la plus populaire de van Vogt. Peut-être a-t-il recherché consciemment ce résultat : l’obscurité du non-A avait suscité de sévères critiques, et il s’est sans doute attaché à y répondre avec un roman parfaitement limpide. Pourtant la préface qu’il a bien voulu écrire spécialement pour le volume du C.L.A. (et où il témoigne de cette immense confiance en lui qui achèverait de le classer, s’il le fallait, parmi les grands créateurs) le montre presque uniquement soucieux de références historiques : les empereurs de Linn combinent des traits empruntés aux Césars (ceux-ci vus à travers le Moi, Claude de Robert Graves) et aux Médicis ; Czinczar le chef barbare est façonné à l’image d’Osman, le fondateur de l’empire ottoman. J’ajoute que, dans le cadre de mes très modestes lumières, le souci de l’analogie m’a paru poussé extrêmement loin : il est clair que Medron Linn est à la fois Auguste et Cosme l’Ancien, et que Clane le mutant, héros de l’histoire, mêle Claude à Laurent le magnifique ; mais il faut ajouter que Lydia est Livie, que le seigneur Tews est Tibère, que Creg et Jerrin sont deux versions de Germanicus et que Calag est Caligula, Van Vogt est si soucieux de précision qu’il joint à son livre une généalogie détaillée de la maison de Linn, qui est un « à la manière de » assez réduit. Ajoutons que les références qu’il avance lui-même sont loin d’être les seules : le sort de Tews capturé par Czinczar à la fin de L’empire de l’atome fut dans la réalité celui de Nicéphore le Logothète, empereur de Byzance, après sa défaite devant les hordes bulgares conduites par le khan Kroum, en l’an 811 de la nativité de Notre-Seigneur. J’en passe et des plus suaves encore. Cette prolifération de références montre que van Vogt, en 1946, était un grand consommateur de livres historiques, et qu’il a essayé de résumer dans L’empire de l’atome son expérience de lecteur d’histoire. Nul doute que l’histoire n’ait été pour lui un remède, à l’instar de la méthode Bates et de la logique de Korzybski : elle l’a aidé à comprendre le monde ou du moins à croire qu’il le comprenait. C’est cette approche du sens de l’univers qu’il a essayé de résumer ici. Et si ces deux romans sont clairement écrits et inhabituellement passionnants, c’est que l’histoire est par nature narrative et brasse les destins individuels par millions. En fait, si Le sorcier de Linn est un roman de structure assez simple, L’empire de l’atome constitue un véritable tour de force : van Vogt y raconte en moins de deux cents pages, de façon très détaillée, une série d’épisodes décisifs de l’histoire du système solaire, qui s’échelonnent sur une durée totale de vingt-sept ans. Et ses personnages ne sont pas moins van vogtiens que d’habitude : le monde est pour eux un mystère qu’ils ne savent comment interpréter ; leurs choix et leurs décisions sont généralement dépourvus de tout motif sérieux. Simplement, au lieu de suivre les méandres de leurs hésitations et de leurs doutes, il les regarde faire de l’extérieur, à la manière des historiens, et il assiste à leurs faux-pas et à leurs échecs avec cette jubilation secrète qui est aussi l’apanage de bien des déterreurs de passé. Ailleurs il dirait que ces hommes sont des thalamiques ; mais ce sont bien les mêmes gamineries qu’il stigmatise en eux dans ce livre. Van Vogt n’est pas le seul auteur de S.F. à avoir abordé de front le problème de l’histoire ; Asimov, pour ne citer que lui, a fait la même chose dans Fondation. La pierre d’achoppement est la même dans les deux cas : l’histoire est passée par définition, et il est difficile d’imaginer des sociétés futures assez régressives pour retrouver les motivations et les valeurs de l’humanité archaïque. Quels que soient les mérites de Fondation, il faut bien dire qu’Asimov s’y est laissé rouler par Toynbee et qu’il applique à un avenir très lointain des schémas parfaitement anachroniques et inadaptés. La solution de van Vogt est beaucoup plus logique : il décrit un univers post-atomique où l’évolution sociale a dû réemprunter certains cheminements du passé ; mais la civilisation technologiquement avancée qui s’est effondrée douze mille ans plus tôt n’a pas disparu sans laisser de traces, et des éléments SF subsistent dans un univers qui ressemble beaucoup à celui de nos ancêtres. Essayez de retourner le problème dans tous les sens, et vous verrez que cette formule est la seule satisfaisante, ou du moins la seule qui n’aboutisse pas à un résultat totalement mythique. Il est certain d’autre part que l’usage de ce qu’on pourrait appeler la dischronie avait, aux yeux de van Vogt, d’autres mérites que la cohérence : Il permettait de montrer côte à côte des duels à l’épée et des voyages interplanétaires, ce qui est depuis Flash Gordon le rêve secret de tous les amateurs de SF épique. Bien des auteurs ont cherché à rendre concevable cette coexistence monstrueuse, à faire un Flash Gordon justifié. Sur ce point encore, la solution de van Vogt a le mérite de la cohérence : les combats à l’arme blanche, les monarchies absolues et surtout les économies esclavagistes seraient impensables si les formes avancées de la technologie conservaient une part consistante dans la vie de la société ; il faut donc qu’elles soient limitées aux voyages et inapplicables ailleurs, secrètes par conséquent, et incomprises de ceux-là mêmes qui les tiennent secrètes, et qui n’en sont dépositaires que par tradition. C’est dire que la science dans une civilisation de ce genre est forcément devenue une religion. Cette idée a été souvent imitée depuis ; elle n’a rien perdu de sa saveur – surtout dans l’original. Remarquons aussi que van Vogt a brillamment résisté à la tentation d’utiliser cette donnée dans le sens de l’heroic fantasy : cette manière ne se manifeste nettement que dans l’épisode de l’invasion de Mars, et la révolte de Vénus elle-même est plutôt traitée comme une guerre du Vietnam avant la lettre. Les dessins de Druillet, par ailleurs fort beaux, donnent un peu l’impression qu’on va se plonger dans une grande épopée, pleine de fracas des hauts faits d’armes ; et l’on tombe sur une chronique vénéneuse et maléfique, pleine d’intrigues de cour et de dosages compliqués. En tout cas van Vogt a su y exprimer le danger d’une façon plus palpable encore que d’habitude : la vie humaine ne tient qu’à un fil dans ces deux romans, même si l’on y fait plus largement usage du poison que de la dague. Et une véritable frénésie de destruction habite des personnages désertés par le plus élémentaire sens commun. C’est dans cette ambiance que Clane le mutant, martyr exemplaire d’une société cruelle, entreprend sa quête personnelle pour retrouver un peu de l’humanité perdue. La clé du problème, pour lui, c’est cet événement mystérieux qui a eu lieu douze mille ans auparavant et qui a précipité la Terre dans la barbarie ; il s’y consacre en historien mais aussi en savant – car ce sont surtout des connaissances qui ont été perdues dans la catastrophe – et finalement en homme d’action et en chef – car ces connaissances peuvent permettre de gagner un nouveau combat. Il s’y consacre avec patience et joue serré pour survivre en attendant d’avoir trouvé : c’est dire que ce solitaire se place lui-même hors de l’histoire et renonce à exercer la plus petite influence sur les événements tant que l’humanité ne rencontre pas le danger essentiel et qu’il n’en a pas trouvé la parade. Mais quand il l’a trouvée, le passé perdu n’a plus de secret pour lui, et il détient l’univers tout entier dans une boîte. C’est dire que le van Vogt que nous connaissons bien finit par se retrouver tel qu’en lui-même dans ce livre. Jacques GOIMARD |
| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |