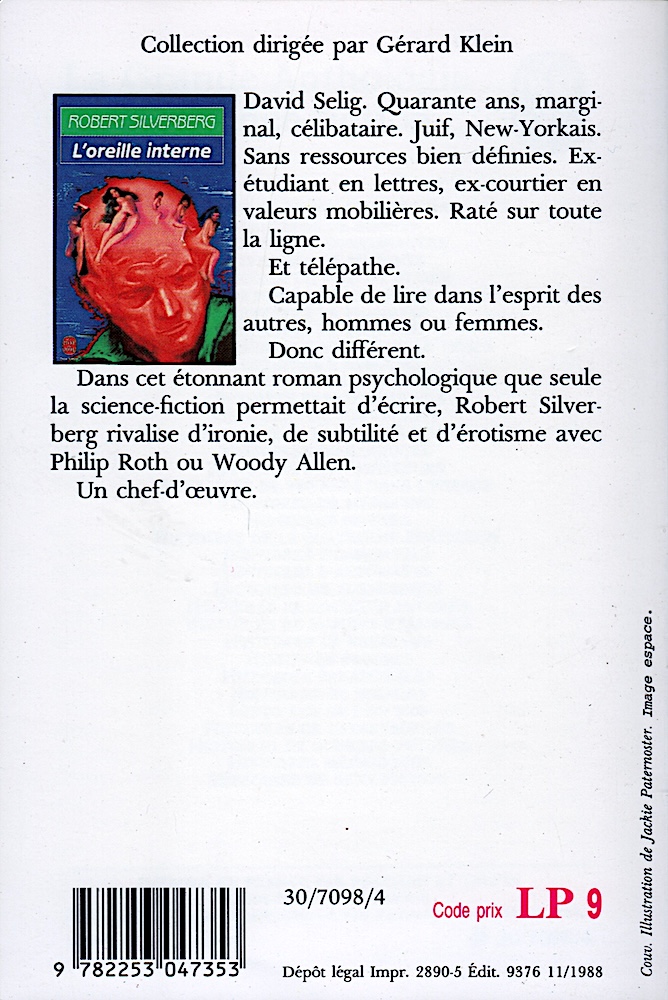|
Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |
|
|
|
Site clair (Changer) | |
| Fiche livre | Connexion adhérent |
|
L'Oreille interne
Robert SILVERBERG Titre original : Dying Inside, 1972 Première parution : Galaxy Magazine, juillet-août et septembre-octobre 1972. En volume : États-Unis, New York : Charles Scribner's Sons, octobre 1972 ISFDB Traduction de Guy ABADIA Illustration de Jackie PATERNOSTER LIVRE DE POCHE (Paris, France), coll. SF (2ème série, 1987-)  n° 7098 n° 7098  Dépôt légal : novembre 1988 Réédition Roman, 288 pages, catégorie / prix : LP9 ISBN : 2-253-04735-X Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction
Autres éditions
GALLIMARD, 2007, 2007, 2010 J'AI LU, 1981 in Voyage au bout de l'esprit, OMNIBUS, 1998 Sous le titre L'Oreille interne Robert LAFFONT, 1975
Quatrième de couverture
David Selig. Quarante ans, marginal, célibataire. Juif, New-Yorkais. Sans ressources bien définies. Ex-étudiant en lettres, ex-courtier en valeurs mobilières. Raté sur toute la ligne.
Et télépathe.
Capable de lire dans l'esprit des autres, hommes ou femmes.
Donc différent.
Dans cet étonnant roman psychologique que seule la science-fiction permettait d'écrire, Robert Silverberg rivalise d'ironie, de subtilité et d'érotisme avec Philip Roth ou Woody Allen.
Un chef-d'oœvre.
Critiques des autres éditions ou de la série
Dans L'Oreille interne, Robert Silverberg cite les ouvrages composant la bibliothèque de son personnage : il y a par exemple des livres de H.G. Wells, Jules Verne, Asimov, Bradbury ou Sturgeon, mais aussi de Faulkner, Hemingway, Céline, Joyce ou Proust 1. Par la composition de cette bibliothèque, Silverberg veut nous faire comprendre qu'il est possible d'écrire un texte qui s'abreuve aux références de la S-F tout en se référant à un contexte littéraire plus large. Ce roman, considéré tour à tour comme une curiosité, puis comme le chef-d'œuvre de Silverberg, se fonde sur un thème classique de science-fiction, la télépathie, en le traitant d'une manière originale : imaginez Joyce écrivant L'Homme démoli. David Selig, juif de New-York, se sait télépathe depuis l'enfance. Il cache soigneusement ce « don », permettant de sonder les pensées des êtres vivants à leur insu, qui lui paraît être une malédiction. Pourtant, lorsque ce pouvoir s'amenuise, la quarantaine venue, David se laisse envahir par une mélancolie incommensurable. Au travers d'une narration introspective, le personnage principal retrace les moments importants de sa vie : sa jeunesse, ses rencontres amoureuses, ses crises existentielles. L'Oreille interne est l'histoire d'un homme, ou plutôt d'une partie essentielle de celui-ci, qui meurt. Les pouvoirs parapsychiques, et plus fortement la télépathie, sont un lieu commun depuis l'Age d'Or de la S-F américaine. Ce thème est exploité soit comme un élément central du roman, comme dans Séquence Sigma (autre titre : Les Six lendemains) de James Blish (1949), A la poursuite des Slans de Van Vogt (1951), L'Homme démoli d'Alfred Bester (1953), Les Plus qu'humains de Théodore Sturgeon (1953), Psi de Lester Del Rey (1971), soit comme un composant de la fiction. Le plus souvent, ces fictions présentent des êtres dont la différence est une source supplémentaire de puissance, surpassant les maigres ressources du simple homo sapiens. Silverberg, de son côté, choisit de développer le thème a contrario. Il montre l'ambiguïté de la télépathie chez David, qui, en se sentant différent des autres, ne parvient pas à se positionner au sein de la société. L'auteur détourne un stéréotype thématique en une tension dramatique. David est l'antithèse du télépathe : bien qu'ayant la possibilité d'ouvrir et de pénétrer l'esprit de quelqu'un, il est lui-même fermé au monde, cloîtré dans un espace intérieur qu'il ne parvient pas à définir exactement. Le personnage principal traverse une double crise existentielle. Tout d'abord, celle d'un être qui ne parvient pas à s'accepter comme il est, puis comme un être perdant ce qui le définissait, sa différence. Le roman exprime aussi bien au travers de la narration que dans le style le mal-être du personnage. Ainsi, l'analyse des oeuvres de Kafka commente en interne une des problématiques de L'Oreille interne, c'est-à-dire « l'impossibilité de la communication humaine 2 ». Le drame de David Selig est qu'il se décrit comme étant un récepteur/réceptacle, qui se nourrit de ce que renferment les autres individus. Cet état de fait implique que le télépathe est une coquille vide et qu'il ne pourrait exister sans la présence de l'autre. L'autre, c'est cette société qui lui renvoie l'image d'un monstre de par sa différence. Par ailleurs, il y a cet autre lui, le télépathe, lorsqu'il parle à la troisième personne, reflet déformé qui semble lui échapper. David Selig est donc étranger au monde et à lui-même. Si au premier abord David est un être vide, la narration remplit le personnage. En effet, celle-ci débute à la première personne, puis, au fil des chapitres, va s'alterner avec la troisième personne, des extraits de journaux intimes et un ton impersonnel. Le style éclaté de la narration montre que le personnage est un être complexe, formé de différentes facettes : temps présent, souvenir de jeunesse, études littéraires, etc. L'enchâssement des différents styles narratifs et surtout les interpellations à un hypothétique lecteur parasitent le discours comme la télépathie de Selig est elle-même parasitée par le temps qui passe. Ainsi, il est difficile de savoir si le personnage s'adresse réellement à quelqu'un ou s'il s'entretient lui-même dans un incessant monologue intérieur. Dans le premier cas, le dialogue fictif démontre un début d'ouverture au monde du télépathe mourant, et dans l'autre cas, le monologue à plusieurs voix de David est pour le lecteur une expérience comparable à la télépathie. Le texte invite alors au voyeurisme de l'introspection d'un être qui regardait à l'intérieur des autres. Par la simplicité du vocabulaire et une narration alternée, Silverberg écrit un roman sur un être exceptionnel qui se considère pourtant comme un moins que rien. Relatant le naufrage d'un être unique dans la masse, Silverberg expose non seulement le mal-être existentiel de la génération vieillissante de l'après 68, mais aussi la dilution d'un personnage stéréotype de la littérature de genre. Négation d'un âge d'or social et littéraire, L'Oreille interne est un roman important. Notes : 1. Silverberg, Robert, L'Oreille interne, J'ai Lu, 1981, p.147-8. Frédéric JACCAUD
Sur un sujet des plus simples (un télépathe de 40 ans voit peu à peu s'effacer ses facultés supranormales), une réussite éclatante. Et d'ailleurs doit-on parler encore, ici, de « sujet » ? Comme pour Le livre des crânes (de valeur égale), Silverberg ne part d'un postulat-SF que pour nous parler de lui (l'auteur a également 40 ans, c'est le début de « l'âge mûr » et de la décrépitude future), nous parler aussi de l'Amérique d'aujourd'hui, où la science — fiction est tout simplement dans la rue. Alors qu'elle se fonde dans le mainstream est de peu d'importance quand elle le nourrit d'aussi belle façon. Sans bruit, en douce, Silverberg est en train de devenir (ou est devenu) le meilleur auteur américain du moment.
Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes
Lorris Murail : Les Maîtres de la science-fiction (liste parue en 1993) Stan Barets : Le Science-Fictionnaire - 2 (liste parue en 1994) Denis Guiot, Stéphane Nicot & Alain Laurie : Dictionnaire de la science-fiction (liste parue en 1998) Association Infini : Infini (1 - liste primaire) (liste parue en 1998) Jean-Pierre Fontana : Sondage Fontana - Science-fiction (liste parue en 2002) Francis Berthelot : Bibliothèque de l'Entre-Mondes (liste parue en 2005) |
| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112198 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |
| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |
| |
|
NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |