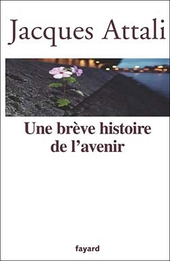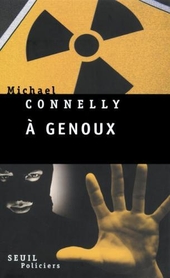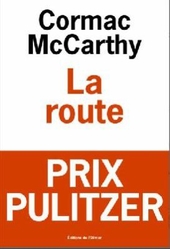|

|
Christian Grenier, auteur jeunesse
|
Recherche
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

|
Ces pages ne seront plus mises à jour ( pour l'instant ...).
Les notes de lecture étant publiées sur le blog chaque semaine, cela devenait difficile de mettre ces pages à jour en parallèle. Donc rendez-vous sur le blog pour les nouvelles "lectures de la semaine" ! CG, le Lundi 18 février 2013 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|